Pourquoi les femmes perdent leur désir sexuel plus vite que les hommes : comprendre le désir féminin et masculin
"Je l’aime, mais je n’ai plus envie. Je me sens vide quand il me touche."
"Moi, je ne comprends pas, j’ai toujours envie d’elle, mais elle me repousse."
D'emblée, ce qu'il est important de spécifier, c'est que ce ne sont pas des caprices. Ce sont deux fonctionnements du désir radicalement différents.
Dans de nombreux couples hétéros, la femme va devenir la gardienne du lien : elle parle pour deux, organise pour deux, ressent pour deux. Progressivement, elle cesse d’être amante pour devenir thérapeute du couple ou mère du lien.
Dans mon cabinet, cette scène se rejoue souvent de façon récurrente : un couple en difficulté sexuelle, un fossé de plus en plus grand entre désir masculin et féminin.
Lui veut "retrouver leur complicité". Elle dit "ne plus ressentir d’attirance".
Mais si la femme perd plus souvent le désir dans le couple, ce n’est pas qu’elle est "frigide", "désinvestie" ou "trop cérébrale". C’est qu’elle ne fonctionne pas sur les mêmes circuits biologiques, hormonaux et émotionnels.
Décryptage sans tabou, ni psychologisation abusive.

1. Le désir sexuel masculin : un circuit réflexe, dopaminergique, orienté vers l’extérieur
Cerveau, verge et visuel : le triptyque du désir réflexe
Chez l’homme, le désir sexuel suit un circuit rapide et réflexe.
Dès qu’un stimulus visuel est perçu (nudité, gestes érotiques, formes corporelles), un signal est envoyé depuis les aires visuelles vers l’aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens, structures cérébrales du système de récompense.
Ces zones déclenchent une libération massive de dopamine, neurotransmetteur du plaisir anticipé, qui pousse l’organisme vers la recherche du plaisir concret : l’acte sexuel. Ce processus agit comme une impulsion de mise en mouvement vers l’acte sexuel.
Simultanément, le cerveau active le système nerveux parasympathique, libérant de l’oxyde nitrique dans les artères du pénis : les corps caverneux se gorgent de sang, entraînant une érection rapide, souvent avant même une prise de conscience claire du désir.
En clinique, cela explique pourquoi certains hommes peuvent avoir des érections sans désir conscient (les fameuses "érections matinales"), ou au contraire perdre leur érection lorsque la situation sociale inhibe le réflexe corporel.
Étude clé : Carani et al. (2005) démontrent que la réponse érectile est largement corrélée au taux de testostérone et à la stimulation visuelle.
Sims et al. (2020) confirment que chez l’homme, l’activation du système de récompense est plus réactive à l’image sexuelle que chez la femme.
Le rôle central de la testostérone
La testostérone est l’hormone-clé du désir masculin (Carani et al., 2005). Elle module la sensibilité du cerveau aux stimuli sexuels et conditionne l’intensité du circuit réflexe. Produite par les testicules, la testostérone agit sur l’hypothalamus et sur les centres du plaisir. Elle module la sensibilité aux stimuli sexuels et l’intensité du désir.
Quand elle baisse (fatigue, stress, andropause, etc.), le désir diminue, même si l’amour persiste. Mais le besoin de stimulation visuelle, lui, reste souvent intact - d’où le recours au porno ou à la masturbation chez certains hommes en couple.
Le désir masculin est historiquement et biologiquement plus axé sur la conquête, la nouveauté et le plaisir immédiat. Cette réalité biologique est amplifiée par les scripts sociaux de virilité, poussant les hommes à rechercher la performance et à valider leur désir par l’acte sexuel.

2. Le désir féminin : un processus relationnel, lent, émotionnel, nourri de sécurité
Le visuel ne suffit pas : la femme désire avec son cerveau social et affectif
Contrairement au fantasme collectif, le désir féminin n’est pas déclenché par un simple stimulus visuel. Il repose sur un circuit plus complexe, activant les zones du lien, de la mémoire émotionnelle et du contexte social (cortex préfrontal, amygdale, hippocampe).
Une femme peut être avec un homme "objectivement" attirant et ne ressentir aucun désir…
Parce que son corps pose une question inconsciente mais cruciale :
"Est-ce que je suis en sécurité ici ? Est-ce que je me sens reconnue, reliée, désirée pour qui je suis ?"
Le contact visuel ou tactile n’est pas suffisant en soi. Le corps féminin répond au lien, pas simplement à l’image. La mentalisation du contexte (qualité de la relation, état émotionnel, souvenirs) module l’accès au désir.
En sexothérapie, cela explique pourquoi certaines femmes "ne ressentent plus rien" avec leur partenaire alors qu'elles peuvent fantasmer ou être réactives en contexte sécurisant, même imaginaire.
Brotto (2018) et Basson (2001) montrent que chez la femme, le désir est souvent réactif, c’est-à-dire activé après une connexion émotionnelle ou sensorielle et non spontané comme chez l’homme.
Le modèle de Basson : le désir féminin est circulaire, pas linéaire
En fait, le modèle linéaire de Kaplan (désir → excitation → orgasme) ne fonctionne pas pour une majorité de femmes.
Basson (2001) a proposé un modèle circulaire du désir féminin :
-
Une femme peut entrer dans un rapport sexuel sans désir initial.
-
C’est la connexion, l’intimité et les caresses qui déclenchent le désir.
-
Le désir naît au cœur de la relation, pas avant.
C’est pour cela qu’une femme peut dire : "Je n’avais pas envie, mais j’ai pris du plaisir quand même".
L’éveil du désir chez la femme dépend donc :
-
De la tendresse perçue.
-
De la présence émotionnelle du partenaire.
-
D’une stimulation sensorielle multimodale (odeurs, caresses, voix).
Un équilibre hormonal plus subtil
Le désir féminin repose sur un cocktail hormonal complexe :
-
Les œstrogènes favorisent la lubrification et la réceptivité.
-
L’ocytocine (hormone du lien) amplifie le désir lorsque la connexion émotionnelle est perçue.
-
La dopamine intervient aussi, mais plus tardivement, comme renforcement du plaisir anticipé.
Ce mécanisme explique pourquoi les femmes peuvent avoir une sexualité intense sans désir préalable : le plaisir vient parfois après l’entrée dans l’acte, lorsque le cerveau valide la sécurité relationnelle.

3. Routine : pourquoi elle éteint plus vite le désir féminin
Est-il vrai que la femme perd plus facilement son désir dans la routine que l’homme ?
Oui… mais c’est plus complexe qu’il n’y paraît. Voici pourquoi :
Le désir féminin : besoin de surprise et de connexion
La routine tue le désir féminin lorsque :
-
La connexion émotionnelle s’efface.
-
Le sentiment d’altérité disparaît.
-
Le corps de l’autre devient un connu sans mystère.
Comme le dit Esther Perel (2016) : "le désir a besoin d’espace pour respirer."
Une relation fusionnelle, trop proche émotionnellement mais appauvrie en nouveauté, éteint peu à peu l’accès au plaisir féminin.
Le désir masculin : aussi sensible à la routine
Chez l’homme, la routine impacte également :
-
Baisse du niveau de testostérone liée à l'âge ou au stress.
-
Monotonie des rapports sexuels (absence de stimulation visuelle nouvelle).
-
Charge mentale ou émotionnelle dans le couple (homme "parentifié", fatigue psychique).
Mais cette baisse est souvent moins perceptible, car le circuit réflexe continue à fonctionner via des fantasmes internes ou l’auto-stimulation (masturbation, pornographie).
Pourquoi le mythe de la "femme frigide" persiste ?
Ce mythe a la peau dure car la perte de désir féminin est souvent plus brutale et visible : de "je ressens du désir" à "je ne ressens plus rien du tout", le passage est rapide.
Chez l’homme, la perte de désir s'exprime plus discrètement (érection moins fiable, baisse de l’initiative sexuelle), mais le désir interne peut persister.
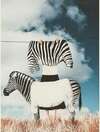
4. Quand la femme porte seule la qualité du lien et ses conséquence sur l'Eros
Au-delà de la charge mentale dont on entend parler de plus en plus souvent ... Il y a le travail émotionnel invisibilisé (Hochschild, 1979)
Dans de nombreux couples hétérosexuels, les femmes endossent, souvent sans s’en rendre compte, la posture de "mère du lien". Elles prennent soin de la relation, anticipent les besoins affectifs, régulent les conflits, organisent les temps d’intimité… au point d’en perdre leur propre désir.
Qu'est-ce que c'est "être mère du lien" ?
Être "mère du lien", c’est :
-
Proposer les moments de discussion ou de retrouvailles ("On se fait une soirée tous les deux ?").
-
Surveiller le climat affectif ("Je sens qu’on s’éloigne…").
-
Être celle qui lit, consulte, propose la thérapie de couple.
-
Se sentir responsable de la santé émotionnelle du duo.
-
Colmater les fuites, gérer les silences, amortir les conflits.
-
Ressentir que "si je ne m’en occupe pas, tout s’effondre".
Cette posture n’est pas choisie librement. Elle s’installe par habitude, injonction sociale, ou par épuisement d’avoir tenté de co-construire sans réciprocité (cf. Titiou Lecoq, Libérées !, 2017).
D'où ça vient ?
Les femmes sont socialisées dès l’enfance à porter la charge émotionnelle :
-
Lire les émotions de l’autre.
-
Réguler les tensions relationnelles.
-
Sauvegarder la cohésion du groupe (famille, couple).
Conséquences cliniques dans le couple
1 - Double charge mentale
-
La femme "mère du lien" porte à la fois la charge du foyer et la charge affective du couple.
-
Elle devient "la responsable du bonheur à deux", mais à quel prix ?
2 - Dysfonctionnements relationnels
-
Asymétrie des rôles : l’homme glisse dans une posture passive, infantile ou consommatrice.
-
Tue-l’amour systémique : la dissymétrie bloque la réciprocité et tue le désir.
-
Épuisement ou burn-out affectif : la femme finit par s’éloigner, se refermer ou quitter la relation.
Amandine, 41 ans, exprime :
"Si je ne propose pas une sortie, un week-end, ou même une discussion, il ne se passe rien. J’ai cette sensation d’avoir une maison vide entre nous, et je suis la seule à vouloir la meubler".
Le désir est ainsi coupé non par désamour, mais par épuisement émotionnel.
Le manque de désir est, dans cette situation, le refus d'une charge supplémentaire qu’est devenue la relation.
Lecture clinique :
Amandine s’est inconsciemment positionnée en gestionnaire du lien. Elle initie, prévoit, maintient et nourrit le "nous". Cette asymétrie affective la vide progressivement de son élan intérieur. Dans le couple, cette compétence devient un travail invisible.
En psychologie clinique du féminin (Cyrulnik, Guédeney), la femme peut inconsciemment se replier sur elle-même lorsqu'elle ressent que son identité propre est absorbée par le couple.
Le retrait du désir devient alors une stratégie de reconquête intérieure, un moyen pour le sujet de poser des frontières là où il ne parvient plus à verbaliser son besoin d'altérité.

Activation biologique du système d’alerte sociale (Guédeney, 2012)
Sur le plan neurobiologique :
-
L’amygdale et le cortex préfrontal médian de la femme détectent plus finement les ruptures de lien.
-
L’ocytocine, libérée par le contact, renforce la vigilance affective.
Cela génère une hyper-sensibilité aux variations émotionnelles dans le couple, qui pousse la femme à “tenir” le lien.
Les conséquences : le piège relationnel et corporel
-
Épuisement émotionnel et perte de désir
Quand elle devient gardienne du couple, la femme :
-
N’est plus amante, mais thérapeute (expliquer pourquoi ça ne va pas) ou mère.
-
Se sent responsable du bonheur à deux.
-
Porte une fatigue émotionnelle qui coupe le désir.
-
Elle porte la charge du maintien du désir, en cherchant des solutions.
Comme l’a montré Harrus-Révidi (2003), ce sacrifice émotionnel s’imprime fréquemment dans le corps :
-
Anesthésie vaginale.
-
Sécheresse.
-
Douleurs inexpliquées.
-
Refus de contact.
-
Le corps entre en inhibition vagale dorsale.
-
Le désir se coupe non par manque, mais comme mécanisme protecteur.
En clinique, cela se traduit par :
"Je n’ai plus envie… mais je me sens aussi anesthésiée émotionnellement."
Le corps dit non pour préserver l'intégrité psychique.Le corps devient le porte-parole silencieux d’un déséquilibre relationnel.
2. Risque systémique : l’homme plus désinvesti affectivement
L’homme, souvent sans malveillance, s’appuie sur le fait que la femme "sent mieux" le lien :
-
Il se repose sur elle.
-
Il pense qu’elle "veut parler" par nature.
-
Il ne voit pas sa propre déconnexion émotionnelle.
Cela creuse ainsi un écart émotionnel, renforçant la solitude féminine.

5. Les tue-l'amour du quotidien : quand le banal abîme l'éros
Dans le travail de réactivation du désir, il est fondamental d’aborder une réalité souvent minimisée : le quotidien peut éroder l’érotisme. Ce ne sont pas forcément les disputes majeures qui vont couper les ailes du désirs féminins. C'est bien souvent l'accumulation de gestes ou d'attitudes qui banalisent le corps, coupent l'imaginaire et désérotisent le lien qui sont à l'oeuvre.
Pourquoi le banal tue le désir ?
Le désir, pour se maintenir, a besoin de :
-
Mystère.
-
Altérité.
-
Un minimum de distinction entre l’espace intime et l’espace fonctionnel.
Quand le partenaire devient un colocataire physiologique, alors l’espace érotique se ferme.
Le corps cesse d'être perçu comme un objet de désir, il devient un objet utilitaire.
Un sondage de Glamour (2011) auprès de femmes révèle que :
-
17 % considèrent qu’un rot est acceptable face à leur partenaire,
-
13 % disent qu’un pet ou uriner l’est aussi,
-
8 % admettent se curer le nez,
-
4 % seraient à l’aise avec une défection
Selon ce sondage, on peut en déduire que la dérogation à l'intimité sensorielle marque un passage à l’acte inapproprié pour 80 % d’entre elles (on peut supposer, par extension, que cela vaut également pour leur partenaire masculin et que ces actes peuvent ainsi devenir de véritables déclencheurs de dégoût, même si l’on compatit à l’aspect corporel.
Voici le top 10 des "tue-l'amour" (liste non exhaustive) :
-
La tenue vestimentaire négligée
Jogging élimé, tee-shirts tâchés, absence totale de soin corporel à la maison.
Le corps se banalise, il n'est plus offert ni regardé.
-
Les rots et les pets en présence du partenaire / se curer le nez
Présentés comme une "preuve de confort" : en réalité, c'est une dissolution du mystère corporel.
Le corps devient un simple tuyau digestif.
-
Se brosser les dents, s’épiler ou aller aux toilettes la porte ouverte
Ce sont des moments où le corps est en posture de soin fonctionnel, non érotique.
Exposer cela tue l'espace de fantasme.
-
Laisser les odeurs corporelles sans hygiène adaptée
Transpiration excessive non prise en compte, haleine forte persistante, etc.
Le corps devient une source de répulsion sensorielle.
-
Parler des problèmes intestinaux ou des hémorroïdes à table ou dans l’intimité
Cela installe une atmosphère non érotique, corps souffrant ou malade.
Cela active chez le partenaire un imaginaire de soin ou de compassion, incompatible avec la pulsion érotique qui a besoin de voir l’autre comme un corps vivant, vibrant, désirable.

-
S’adresser à l’autre comme à un enfant ("tu as bien fait caca aujourd’hui ?")
Infantilisation du partenaire = désactivation immédiate de la polarité sexuelle.
Le partenaire cesse d’être un sujet érotique pour devenir un être fragile à rassurer ou à materner. Or, l’érotisme se nourrit de la tension entre deux adultes différenciés.
-
Ne plus se regarder en se parlant
L'absence de regard transforme la communication en simple échange fonctionnel.
Le regard est un acte de reconnaissance érotique : il dit "je te vois comme un être vivant et désirable".
Quand les partenaires cessent de se regarder, alors la relation devient fonctionnelle (comme deux collègues) et le lien corporel s’efface.
Le regard est le premier geste sexuel du quotidien. Le désir meurt dans l’invisibilité mutuelle.
-
Utiliser des surnoms désexualisants ("ma petite crotte", "mon p’tit loup tout baveux")
Cela induit un imaginaire incompatible avec l’excitation. Pourquoi cela tue le désir ?
Ces surnoms activent un imaginaire digestif ou grotesque, incompatible avec la projection érotique. Le cerveau associe inconsciemment le partenaire à une figure ridicule, pas à un objet du désir.
Le surnom installe un récit relationnel asexué.
-
Manger bruyamment ou négligemment (bouche ouverte, aliments qui coulent), se curer les dents
Détails sensoriels qui activent le dégoût plus que le désir. Pourquoi cela tue le désir ?
L’ingestion bruyante ou salissante active le dégoût sensoriel.
Le bruit de mastication ou la vue de salive/ aliments en excès exposent un corps physiologique, ramenant l’autre à sa dimension animale brute.
Cela efface la part symbolique et érotique du corps humanisé.
-
Être "prêt(e) à dormir" :
Rentrer à la maison, se mettre immédiatement en pyjama / jogging et s’écrouler sur le canapé (voire s'endormir en ronflant).
Pourquoi cela tue le désir ? L’effondrement postural et la tenue vestimentaire purement fonctionnelle désactivent le regard érotique :
- Le corps cesse d’être offert.
- Il devient un simple outil de repos ou de récupération.
Le partenaire perçoit l’autre non comme un être vivant et vibrant, mais comme un corps usé qui demande le sommeil. Le désir ne peut naître dans l’absence totale d’élan corporel. CQFD

Nota :
-
Ces actes ne sont pas des défauts. Ils désactivent simplement le corps comme espace érotique.
-
Le désir a besoin d’une part de mise en scène, non par artifice, mais par choix conscient de garder un espace érotique ouvert.
-
Soigner le corps et l’espace visuel, c’est prendre soin du désir du couple, non se trahir soi-même.
-
Le désir n’est pas un acquis. C’est un jardin.
Ces petits actes du quotidien sont des mauvaises herbes : ils ne tuent pas d’eux-mêmes le lien, mais accumulés, ils envahissent l’espace du désir.

6. S'en sortir grâce à la thérapie de couple
En thérapie de couple, on vient réparer cela selon plusieurs axes d'action. En voici quelques-uns :
-
Identifier ensemble les dynamiques invisibles :
-
Qui porte le lien ?
-
Qui veille à la qualité relationnelle ? Qui veille à la connexion ? Qui s’inquiète du désir ? Qui a proposé la thérapie ?
-
Quels gestes du quotidien désactivent l’attirance ?
Nommer : "le lien est un espace commun. S’il est porté par une seule personne, ce n’est plus un couple, c’est une mission".
-
Nommer le déséquilibre sans juger :
La responsabilité du lien doit être partagée. Le lien est une responsabilité partagée.
Le corps du partenaire doit rester un espace de mystère et de désir, pas devenir un simple corps "utile". Proposer des actes concrets au quotidien.
3. Redistribuer les rôles :
-
Apprendre à l’homme (ou au partenaire) à reprendre sa part dans l’animation du lien.
-
Permettre à la femme de déposer le fardeau, de retrouver un espace intérieur qui n’est plus au service du couple mais au service de son propre désir.
-
Restaurer le corps désirant de la femme (Harrus-Révidi, 1995) :
-
Détecter les tue-l’amour spécifiques au couple.
-
Restaurer des gestes de prise de soin corporelle et sensorielle : regard, tenue choisie, caresses non fonctionnelles ou à visée exclusivement sexuelle.
-
Travail psycho-corporel : recontacter le plaisir pour elle-même, non comme outil de maintien du couple.
-
Pratiques corporelles : danse sensorielle, respiration consciente.
-
Défusionner le lien : recréer un espace personnel pour réactiver le désir.
-
Réapprendre à se voir comme corps vivant, pas comme fonction parentale ou logistique.
-
Réenchanter le lien :
-
Par des rituels simples : repas partagés sans smartphone, soirées habillées, regards conscients, mots choisis.
-
Non pour "sauver le couple", mais pour réinjecter du vivant dans la relation.
Le but n’est pas de jouer un couple parfait.
Le but, c’est de rendre au lien sa respiration.
De permettre au corps de la femme de redevenir un corps désirant,
Et au partenaire de redevenir amant, pas assisté émotionnel ou cognitif.

Conclusion
Le désir féminin ne disparaît pas sans raison : il s’éteint sous le poids du lien et du quotidien
De nombreuses femmes cessent de ressentir du désir non par absence d’amour, mais parce que le couple a cessé d’être un lieu où elles peuvent se déposer.
Quand la femme devient gardienne du lien, elle bascule du rôle d’amante à celui de thérapeute ou de mère.
Et dans le même temps, les petites anesthésies du quotidien (pyjamas informes, absence de regard, propreté douteuse, etc.) désactivent l’espace érotique.
Leur désir ne disparaît pas : il se retire. C’est un signal de protection, pas une pathologie.
Réparer le couple n’est pas sauver le désir féminin : c’est rendre au lien sa respiration
La thérapie de couple permet de :
-
Rendre visible la charge invisible et redistribuer la charge émotionnelle du couple : qui porte le lien ? Qui initie ? Qui répare ? Le portage du lien par une seule personne tue l’érotisme en créant une posture sacrificielle.
-
Redistribuer la responsabilité du lien : hommes ou femmes, chacun peut apprendre à prendre soin / nourrir au quotidien le "nous". Le désir féminin est relationnel, il s’épanouit quand la responsabilité du lien est partagée.
-
Recréer un espace corporel, sensoriel et imaginaire où le désir a une place.
-
Découvrir les tue-l’amour invisibles et réintroduire la part symbolique du corps dans la relation. Les tue-l’amour ne sont pas des défauts personnels, mais des signaux d’alerte d’une banalisation du corps et du lien.
Mais cela ne suffit pas toujours. Certaines femmes ne peuvent réouvrir leur désir sans un travail plus profond sur leur histoire d’attachement, leurs traumatismes corporels, leur rapport à la maternité ou à la charge mentale.
Le désir féminin n’est pas une mécanique : c’est une danse intérieure, souvent blessée.
Vers une sexualité vivante et consciente : restaurer le couple comme espace co-construit pas en mission sacrificielle
Dans chaque couple, il existe un moment où le corps dit : "je ne veux plus porter seule cette relation".
Et c’est là que commence le travail thérapeutique :
-
Redonner au lien son statut de création commune. Le lien devient une responsabilité à deux.
-
Permettre au corps féminin de redevenir un espace désirant, non une zone de compensation émotionnelle. Chacun redevient sujet de son propre désir, sans se sacrifier pour l’autre.
-
Inviter chacun à réhabiter son rôle d’amant, d’amante, de partenaire conscient. Le corps retrouve son altérité, son mystère et son pouvoir d’éveil.
Le désir féminin n’est ni fragile ni capricieux. Il est sensible au climat du lien.
Le désir féminin ne s’éteint pas par faiblesse. Il se retire quand le couple cesse d’être un lieu de circulation du vivant.
Et lorsque le couple redevient un lieu respirant, différencié et respectueux, alors, parfois, le désir réapparaît.
L’enjeu thérapeutique est de ranimer le feu du lien, sans demander à la femme d’en porter seule la flamme.
Bibliographie
-
Bowlby, J. (1969-1980). Attachement et perte (3 tomes). Paris : PUF.
-
Brody, S. (2022). The clarity of connection: Female desire and long-term bonding. Londres : Routledge.
-
Castelain-Meunier, C. (2002). La place des pères. Paris : PUF.
-
Castelain-Meunier, C. (2017). "Charge mentale, charge affective : pourquoi les femmes portent tout ?", entretien, La Vie des idées, 14 décembre 2017.
-
Cyrulnik, B. (2001). Les Nourritures affectives. Paris : Odile Jacob.
-
Sur l'attachement, les transmissions affectives et la construction du lien comme sécurité corporelle et émotionnelle.
-
Flaumenbaum, D. (2006). Femme désirée, femme désirante. Paris : Payot.
-
Guédeney, N. (2022). L’attachement : Approche clinique et développementale. Paris : PUF.
-
Haicault, M. (1984). La charge mentale ou le coût psychique du travail domestique. Paris : CNRS Éditions.
-
Harrus-Révidi, G. (2003). Le Sexe et le Corps féminin : une approche psycho-somatique de la sexualité. Paris : L’Harmattan.
-
Comment le corps féminin se ferme sous le poids du sacrifice relationnel et du déséquilibre systémique.
-
Illouz, E. (2012). Pourquoi l’amour fait mal : L’expérience amoureuse dans la modernité. Paris : Seuil.
-
Kaufmann, J.-C. (1992). La trame conjugale : Analyse du couple par son linge. Paris : Nathan.
-
Kaufmann, J.-C. (1999). La femme seule et le prince charmant. Paris : Pocket.
-
Kaufmann, J.-C. (2014). Quand je est un autre : Pourquoi et comment devient-on quelqu’un d’autre ? Paris : Armand Colin.
-
Lecoq, T. (2017). Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Paris : Fayard.
-
Perel, E. (2007). L’intelligence érotique : Rester désirable quand on aime. Paris : Robert Laffont.
-
Esther Perel (2017). Je t'aime, je te trompe : repenser l'infidélité pour réinventer le couple. Paris : Robert Laffont.
-
Persiaux, G. (2021). Guérir des blessures d’attachement : Cheminer vers un lien à soi et aux autres plus apaisé. Paris : Odile Jacob.
-
Porges, S. (2017). La théorie polyvagale : Régulation physiologique de l’engagement social. Paris : Sully.
-
Schneider, A. (2018). La charge mentale des femmes… et celle des hommes. Paris : Larousse.
- Patron S :
https://shs.cairn.info/recits-de-la-charge-mentale-des-femmes--9791037020185?lang=fr
https://shs.cairn.info/article/QDC_044_0452
- Malaterre J. : https://shs.cairn.info/revue-contraste-2022-2-page-241?lang=fr
-
Haicault M. (1984). La charge mentale ou le coût psychique du travail domestique. Paris : CNRS Éditions. https://shs.cairn.info/recits-de-la-charge-mentale-des-femmes--9791037020185-page-21?lang=fr
-
Le Monde, Dossier "La charge mentale, ce fardeau invisible", 2017.
-
Basson, R. (2001). "Using a different model for female sexual response to address women's problematic low sexual desire." Journal of Sex & Marital Therapy, 27(5), 395-403.
Modèle circulaire du désir féminin, fonction du lien émotionnel dans le déclenchement du désir sexuel.
-
Brotto, L. A. (2018). Better Sex Through Mindfulness: How Women Can Cultivate Desire. Greystone Books.
Approche corporelle et pleine conscience dans la réactivation du désir féminin dissocié.
-
Carani, C., et al. (2005). "Testosterone and sexual function in men." The New England Journal of Medicine, 353(10), 1027-1035.
Rôle central de la testostérone et du réflexe visuel dans le désir masculin.
-
Sims, K. E., et al. (2020). "Neuroendocrinology of human sexual behavior." Endocrinology and Metabolism Clinics of North America, 49(3), 401-418.
Bases neuro-endocriniennes du désir sexuel, différences hormonales homme/femme.
-
Baumeister, R. F. (2000). "Gender differences in erotic plasticity: The female sex drive as socially flexible and responsive." Psychological Bulletin, 126(3), 347-374.
Théorie de la plasticité érotique : désir féminin plus contextuel et adaptable que le désir masculin.

NeoSoi - Dr Céline BERCION - psychologue sociale et systémique, thérapie de couple et sexothérapie - Bordeaux et visio
36 Avenue Roger Cohé
33600
Pessac
France
Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités

