Fantasmes féminins et masculins : les comprendre pour mieux en parler, renforcer l’intimité et nourrir le désir en couple
Selon l’IFOP, plus de 70 % des Français n’ont jamais confié leurs fantasmes à leur partenaire. Oui, vous avez bien lu : 70%.
Le résultat ? Des couples qui s’aiment mais qui s’éteignent. Pas à cause du manque de désir, mais à cause du silence.
Imagine. Elle se tourne dans le lit, le dos collé à son téléphone, persuadée qu’il ne la touche plus par désintérêt sexuel. Lui, bandant en silence, s’imaginant ailleurs. Leurs corps s’éloignent, leurs imaginaires s’enflamment… mais pas ensemble. Et c'est ce non-dit qui devient encore plus corrosif qu’une infidélité.
A y regarder de plus près, un fantasme, c’est un peu comme une grenade dégoupillée : gardé pour soi, il peut détruire la complicité. Jeté en pâture comme élément de chantage, il peut générer du dégoût rédhibitoire. Et dans ce continuum, partagé avec délicatesse, il peut aussi devenir une source de renaissance. C’est même parfois la seule respiration érotique qui sauve un couple de la routine.
Alors la vraie question n’est pas "quels fantasmes avons-nous ?", mais : oserons-nous les dire, les écouter et en faire un terrain de jeu ?
Dans cet article, je vais vous révéler les 5 fantasmes les plus fréquents chez les femmes, les 5 chez les hommes et, surtout, comment en parler sans peur pour transformer un imaginaire secret en levier de désir et d’intimité profonde dans son couple.

1. Le tabou qui étouffe
En France, on parle plus facilement d’argent ou de politique… que de fantasmes. En effet, sept couples sur dix n’ont jamais osé parler de leurs fantasmes. Et ce chiffre, révélé par l’IFOP, n’est pas qu’une statistique : il raconte des millions de lits où le désir s’étouffe chaque soir dans le silence.
Imagine. Elle voudrait lui dire qu’elle rêve d’un inconnu qui la prend sans douceur. Mais dans sa tête, une voix la coupe net : "Tu serais une salope et drôlement détraquée si tu dis ça".
Lui aimerait avouer qu’il fantasme d’être caressé par les pieds de sa compagne, ou même pénétré par elle avec un gode-ceinture. Mais rien ne sort : "Si je dis ça, je ne suis plus un homme. Elle me verra comme une merde, pas comme son mec".
Alors ils se taisent. Ils dorment ensemble, mais chacun brûle dans sa solitude. Madame souffle, tourne le dos, s’accroche à son téléphone pour ne pas sentir le vide. Monsieur, derrière, retient sa respiration, honteux de bander pour une scène qu’il n’osera jamais dire. Parfois, il se lève, se soulage en cachette dans la salle de bains et revient comme si de rien n’était. Deux solitudes sous la même couette. Le lit devient une zone morte. Pas de drame, pas de cris. Seulement l’érosion lente, presque invisible, du désir.
En fait, un fantasme fonctionne comme une grenade dégoupillée. Tant qu’il reste coincé dans la tête, il corrode le couple en fissurant le lien de l’intérieur. Et puis un jour, il explose ailleurs : dans une infidélité nocturne, dans une rancune qui pourrit tout, dans ce dégoût qui s’installe au point qu’on n’ose plus se toucher.
Ce que l’on tait finit toujours par se venger.

Mais ce silence n’est pas qu’une pudeur individuelle : il est écrit par la société.
-
Elle a appris qu’une femme devait être désirée, mais jamais prendre trop d’initiatives. Alors elle se tait quand elle rêve d’un plan à trois, de peur de passer pour une "vicieuse".
-
Elle a entendu qu’une bonne compagne pense d’abord au bien-être de l’autre. Alors elle se tait quand la pénétration lui fait mal, parce que "il en a besoin".
-
Elle sait qu’une mère respectable n’a pas de fantasmes non respectables. Alors elle efface son imaginaire après la naissance des enfants, comme si la maternité avait annulé sa sexualité.
-
Lui, de son côté, a intégré qu’un homme doit toujours avoir envie. Alors il se force, même épuisé, plutôt que d’avouer son absence de désir.
-
Lui a appris qu’un vrai homme ne dit pas non. Alors il accepte des pratiques qu’il ne veut pas, de peur de passer pour un faible.
-
Lui sait qu’un homme doit être performant, pas vulnérable. Alors il garde pour lui son fantasme d’être dominé, de peur d’être jugé comme "moins homme".
Ces normes ne sont pas neutres. Elles enferment. Comme l’ont montré Nathalie Bajos et Michel Bozon, la sexualité est toujours prise dans des scripts sociaux : des rôles implicites qui écrivent la scène du lit à la place des partenaires. Chaque scène intime est dictée par des rôles implicites : elle doit séduire sans désirer trop ; il doit désirer sans douter.
Eva Illouz appelle cela le paradoxe de l’amour moderne : on attend une transparence totale dans le couple, mais les normes patriarcales rendent impossible la parole sur les désirs "hors cadre".
Voilà pourquoi, dans sept lits sur dix, le silence règne. Pas parce que les couples n’ont pas de fantasmes. Mais parce que chaque fantasme est jugé à travers un filtre social : la femme qui désire trop = la pute ; l’homme qui doute = le faible.
Alors posons la vraie question :
Les couples meurent-ils d’un manque de sexe ? Non. Ils meurent d’un tabou : l’interdit de dire, l’interdit d’avouer, l’interdit de partager ce qui nous brûle vraiment.

2. Qu'est-ce qu'un fantasme ?
Tout le monde fantasme. Même vous qui lisez ces lignes.
Si vous croyez ne pas en avoir, c’est soit que vous mentez, soit que vous les avez enfouis si profondément que vous ne les sentez plus.
Un fantasme, ce n’est pas un projet, ni une promesse, ni un passage obligé. C’est une scène intérieure : un film mental qui surgit parfois sans prévenir, parfois comme une obsession qu’on rejoue en boucle. Il peut durer trois secondes ou hanter toute une vie. Parfois, c’est une image furtive ; parfois, c’est une histoire entière.
Mais le fantasme a toujours le même pouvoir : mettre le corps en feu.
Et ce feu n’est pas toujours doux. Il peut réchauffer, rassurer, nourrir. Mais il peut aussi brûler, consumer, laisser une trace de honte. On peut fantasmer sur un inconnu, sur une relation interdite, sur un scénario qu’on jugerait intolérable dans la réalité. Et se réveiller avec le ventre noué : "Comment ai-je pu penser ça ?".
Les chercheurs l’ont montré : il n’y a rien de plus normal. Justin Lehmiller a interrogé des milliers de personnes : 97 % fantasment des choses qu’ils n’osent pas dire. Christian Joyal a démontré que même les scénarios jugés "déviants" (bondage, voyeurisme, plan à trois, etc.) sont en réalité parmi les plus fréquents. A ce sujet, Philippe Brenot parle d’"imagination érotique" : un carburant universel du désir.
Alors si vous pensez être seul avec vos images "bizarres", détrompez-vous : elles sont partagées par des millions d’autres personnes. Ca vous rassure ? Alors tant mieux.
Mais un fantasme n’est pas un désir prêt à être vécu. On peut fantasmer d’infidélité sans vouloir tromper. On peut fantasmer d’être humilié sans jamais vouloir le subir. En fait, le fantasme est un espace de liberté totale parce qu’il ne met en jeu que l’imaginaire. Et c’est précisément cette liberté qui rend ses scénarios parfois si excessifs : ils n’ont pas à être raisonnables.

Les différences culturelles dans les fantasmes
Pourtant, les fantasmes ne naissent pas dans le vide. Nathalie Bajos et Michel Bozon l’ont montré : le fantasme n’est pas seulement individuel ni biologique. C’est aussi une production culturelle. Ce que l’on ose imaginer, ce qui excite ou fait honte, dépend beaucoup du contexte social et historique. Les fantasmes suivent des scripts sociaux :
- En France / Europe occidentale, où la liberté individuelle est valorisée mais où le patriarcat reste fort, les enquêtes internationales (Lehmiller, Joyal) montrent que les fantasmes tournent souvent autour de la pluralité (plan à trois), du pouvoir (soumission/domination / BDSM léger) ou de la transgression mesurée (lieu public).
- En Afrique, des anthropologues (par ex. Obbo, 2006 sur l’Ouganda ; Deschamps, 2010 sur le Sénégal) montrent que les fantasmes intègrent souvent le collectif et le spirituel. La sexualité y est pensée en lien avec la fertilité, l’ancestralité ou même la sorcellerie. Les fantasmes des femmes sont plus orientés sur des scenariis du typoe faire l’amour avec des esprits ou des ancêtres (preuve que le fantasme y garde une dimension spirituelle et collective).
- En Asie, notamment au Japon, les études (notamment Bozon et Le Van, 2017, sur la comparaison interculturelle) montrent que le voyeurisme/exhibition et les fantasmes de scénarios codifiés (costumes, hiérarchies) sont beaucoup plus fréquents. Pourquoi ? Parce que les cultures où la sexualité publique est plus contrainte créent des imaginaires où le rituel et le rôle social deviennent excitants. Ainsi, on comprend pourquoi beaucoup d’hommes fantasment sur des costumes scolaires ou des scénarios codifiés : ce qui excite, c’est le rituel, la hiérarchie, la mise en scène.
En clair :
-
En Occident → fantasmes = transgression individuelle.
-
En Afrique → fantasmes = lien avec le collectif, le spirituel.
-
En Asie → fantasmes = scénarios codifiés, rôle, hiérarchie.

Autrement dit surtout : un fantasme est toujours intime, mais il porte la marque d’une culture. Il dit quelque chose de nous, mais aussi de la société qui nous a façonnés. Et si les couples français meurent souvent de silence, c’est parce que ce silence est nourri par un tabou double : des femmes qui doivent encore retenir, des hommes qui doivent encore prouver.
Et il dit même plus encore. Un fantasme, c’est une porte de l’inconscient :
- Derrière la soumission consentie se cache la quête archétypale de l’abandon et de la confiance.
- Derrière le plan à trois, le besoin archaïque d’être reconnu par plusieurs regards à la fois.
- Derrière l’inconnu, l’appel de l’ombre, du mystère jungien.
In fine, chaque fantasme est une flamme qui éclaire nos parts cachées : vulnérabilité, puissance, fusion, liberté, etc.
Alors finalement, qu’est-ce qu’un fantasme ?
C’est un feu intérieur universel, façonné par les scripts sociaux, nourri par les archétypes, parfois tendre, parfois honteux, toujours révélateur.
Ce n’est pas le problème.
Le vrai problème, c’est que dans sept couples sur dix, ce feu brûle en silence, sans jamais être partagé. Et c’est ce silence-là qui, plus sûrement que tout, finit par tuer le désir.

3. Le feu secret du féminin
Les fantasmes féminins sont des braises qu’on ne dit pas. Non pas parce qu’ils seraient rares, mais parce qu’ils sont dangereux à avouer. Avouer, c’est risquer d’être jugée, méprisée, quittée. C’est porter la honte de siècles où l’imaginaire érotique féminin a été traité comme un vice ou une folie.
Ce tabou n’est pas neuf. Pendant tout le XIXe siècle, les fantasmes étaient d'ailleurs classés dans les "perversions sexuelles" : sadisme, fétichisme, inversion… L’imaginaire sexuel était même un symptôme de maladie, une preuve de dégénérescence. Et même si les recherches modernes (Masters & Johnson, Brenot, Joyal, Lehmiller) ont montré qu’ils sont universels et normaux, la honte est restée inscrite dans nos corps.
Les grands fantasmes féminins
Elle ferme les yeux et s’imagine désirée par deux partenaires à la fois. Pas pour collectionner, mais pour sentir son corps célébré, saturé de regards et de mains. Dans sa tête, ça crie : "Tu n’es qu’une pute si tu dis ça". Voilà le tabou. Dans une culture où une femme doit rester désirable mais pas trop désirante, ce fantasme est un acte de rébellion intérieure. Il dit : "Je prends toute la place".
Une autre femme rêve de se laisser attacher, bander les yeux, guidée sans avoir à décider. Le corps livré, mais enfin relâché. Toute la journée, elle tient : enfants, travail, maison, mari. Dans sa scène intérieure, elle tombe. Et quelqu’un la rattrape. Ce n’est pas de la soumission, c’est la respiration qu’on lui refuse ailleurs. Mais si elle l’avouait ? "Tu es vraiment tordue. Tu aimes être humiliée". Voilà pourquoi elle se tait.
D’autres imaginent une scène en public : un escalier, un ascenseur, une ruelle. Pas pour être vues, mais pour sentir l’interdit, la morsure du risque. Depuis petites, elles ont appris : "Ne fais pas de bruit, ne dérange pas, ne prends pas de place". Ici, elles osent l’inverse : défier le monde, s’exposer au danger, sentir que leur désir peut griffer la norme.
Beaucoup rêvent aussi d’un inconnu. Un visage flou, un corps sans nom. En France, c’est souvent un amant croisé dans un bar ou une rue. Au Sénégal, des anthropologues rapportent des femmes qui rêvent d’un esprit ou d’un ancêtre qui les visite la nuit. Au Japon, l’inconnu prend parfois l’uniforme d’un supérieur hiérarchique. Partout, c’est la même force : l’appel du mystère, l’irruption de l’inédit dans une vie trop cadrée.
Enfin, certaines s’imaginent dominées. Pas pour être rabaissées, mais pour se débarrasser du masque de la femme forte. Elles qui "tiennent" tout finissent par rêver de ne plus rien tenir. Ce n’est pas perdre le pouvoir, c’est lâcher le rôle. Mais là encore, l’insulte guette : "T’as un problème. Tu es malade". Alors elles se taisent, et ce feu reste souterrain.
En fait, chaque fantasme féminin est une fracture / tension intime.
-
Il dit la femme désirante dans un monde qui ne veut d’elle que désirable.
-
Il dit la femme libre dans un monde qui la préfère docile.
-
Il dit la femme mystérieuse dans un monde qui la veut transparente.
Et c’est précisément parce qu’ils révèlent cette tension que ces fantasmes restent secrets. Parce qu’une femme qui avoue trop de désir, trop de mystère ou trop de lâcher-prise risque encore d’être rejetée.

4. Le feu brut du masculin
Le fantasme masculin est comme un feu brut, violent. Derrière la façade de la virilité, il dit surtout autre chose : la peur de disparaître, la faim de reconnaissance, le désir inavoué d’abandon. Et c’est précisément parce qu’il touche ces fractures archaïques que l’homme se tait.
Quelques exemples de fantasmes masculins
Il rêve de deux femmes. Scène classique : lui au centre, deux corps pour le célébrer. Mais derrière l’orgie se cache une angoisse plus vieille que lui : la peur de n’être pas assez. Deux femmes pour combler le vide d’une seule voix intérieure qui répète : "Tu n’es pas à la hauteur".
S’il l’avoue à sa compagne ? Elle pourrait y entendre : "Je ne te suffis pas". Et le fantasme, qui était une bouée contre son angoisse, devient alors une arme qui détruit le couple.
Un autre imagine un plan à trois avec un autre homme. Pas pour l’aimer, mais pour se mesurer. Dans sa tête, ce n’est pas un jeu, c’est un combat : deux coqs, une seule proie. Mais quand le fantasme se termine, il se dégoûte. "Putain, je suis une tapette ou quoi ! " Voilà la double brûlure : excitation fulgurante, puis auto-destruction.
Certains rêvent aussi de passivité totale. Ne rien faire. Être choisi, désiré, pris en charge. Être l’objet, pas le sujet. Mais sitôt joui, la voix intérieure écrase : "Tu es une merde. Un homme ne doit pas attendre, il doit prendre". Cette honte post-fantasme est l’une des plus cruelles : il a bandé sur une image qui le renvoie à tout ce qu’on lui a interdit d’être.
D’autres enfin fantasment sur la tendresse. Un rapport lent, caressé, doux. Un sexe sans performance, juste la fusion. Mais là aussi, c’est tabou. Parce qu’un homme doit être animal, pulsionnel, conquérant. Avouer qu’il rêve d’un rapport tendre, c’est risquer de passer pour faible. "Elle se foutra de ma gueule. Elle ne me verra plus jamais comme un vrai mec".

Et il y a ceux qui brûlent de l’interdit social.
-
En France, c’est l’exhibition : être surpris, prouver devant les autres. Mais derrière l’orgueil, il y a la peur archaïque d’être invisible. "Si on ne me regarde pas, est-ce que j’existe encore ?"
-
En Afrique, beaucoup rêvent de fécondité. L’homme sénégalais qui s’imagine engrosser une dizaine de femmes, comme si son nom ne survivrait que dans le nombre d’enfants. Là, le fantasme n’est pas individuel : il est collectif, inscrit dans la lignée.
-
En Asie, au Japon, certains hommes n’ont d’érection qu’en imaginant un rôle codifié : professeur et élève, supérieur et subordonné. Ici, le désir ne jaillit pas du chaos, mais du rituel. Sans ce décor hiérarchisé, le feu s’éteint.
Tout comme pour les femmes, chaque fantasme masculin est une fracture intime.
-
Derrière le duel, il y a la peur d’être écrasé.
-
Derrière l’orgie, l’angoisse d’être vide.
-
Derrière la tendresse rêvée, la honte de paraître faible.
-
Derrière l’abandon, la voix qui hurle : « Tu n’es pas un homme. »
Et c’est là que le tabou devient meurtrier. Parce qu’un homme qui ose avouer risque gros. Il risque le rire de sa compagne, le mépris, la perte du désir. "Tu veux ça ? Ah mais tu me dégoûtes". En une seconde, son fantasme intime peut devenir le début de sa solitude conjugale.
Alors il se tait. Et ce feu brut, au lieu d’éclairer, se consume de l’intérieur.

5. Quand les feux se croisent : malentendus et étincelles
Dans l’intimité, fréquemment, les feux féminins et masculins ne s’additionnent pas : ils s’entrechoquent.
Chacun croit se livrer et, au final, chacun se sent fréquemment trahi.
Un soir, lors d'une discussion légère autour d'un bon verre, elle ose lui lancer : j’imagine un inconnu qui me prend sans prévenir… "
Il se fige. Dans sa tête, ça explose : "Donc je ne te suffis pas ? Tu veux me tromper ?"
Pour elle, c’était le souffle du mystère, l’envie d’échapper à la routine conjugale. Pour lui, c’est une menace directe à son rôle d’homme "qui doit tout donner".
Un autre soir, c’est lui qui se risque : "j’ai toujours fantasmé sur deux femmes à la fois…"
Elle se crispe. Elle entend : "je ne suis qu’une moitié, jamais assez."
Pour lui, c’était l’appel archaïque à être célébré, validé. Pour elle, c’est l’angoisse d’être réduite à un corps parmi d’autres.
On comprend dès lors que ces braises ne se traduisent pas. Bien souvent, trop souvent, elles se heurtent.
-
Elle rêve de se laisser attacher, comme dans un abandon. Lui n’y voit que de l’humiliation : "t’as un problème, tu veux qu’on te maltraite".
-
Il rêve de passivité, d’être choisi. Elle entend désertion : "donc tu ne veux plus de moi, tu ne veux plus me désirer".
-
Elle imagine une scène en public pour sentir l’interdit. Lui veut exhiber sa puissance. Le point commun : ils parlent tous les deux de danger, mais pas du même.
Et quand les fantasmes ne sont pas dits mais découverts "par hasard", la bombe explose.
- Elle tombe sur son historique porno saturé de threesomes (parties à 3) et de domination. Elle se sent réduite à un cliché, comme si elle n’était qu’un rôle de plus dans son théâtre secret. Ca la dégoûte.
- Il découvre son journal où elle décrit l’inconnu qui la prend dans une chambre d’hôtel. Pour lui, ce n’est pas une fiction : c’est une infidélité écrite. Ca le répugne.
Le fantasme devient alors poison. Pas parce qu’il existe, mais parce qu’il n’a pas été parlé.
Mais il y a aussi ces couples qui osent rester dans le brasier, sans fuir.
Il dit, parfois du bout du lèvres : "j’ai honte, mais j’ai envie d’être passif".
Elle tremble et lui murmure : "ça me déstabilise… mais peut-être que ça m’excite de prendre ta place".
Elle lui confie : "je m’imagine avec un inconnu".
Il respire et lui sourit : "je ne suis pas lui. Mais si tu veux, je peux devenir celui qui te surprend".
Alors, les flammes cessent de s’affronter. Elles se rapprochent, se parlent, se mélangent. Ce n’est plus une explosion qui détruit, mais un feu de camp où l’on se raconte, où l’on ose.
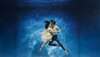
6. La science qui rassure : vous êtes normaux
Après l’orage des révélations, une question revient très fréquemment : "est-ce que c’est normal ?"
La science répond : oui, c’est normal. Mais longtemps, elle a dit l’inverse. Je l'ai déjà écrit précédemment dans cet article, mais il me semble essentiel de le répéter voire de le marteler.
Pendant tout le XIXᵉ siècle, les fantasmes étaient classés comme des "perversions".
Krafft-Ebing recensait le sadisme, le fétichisme et l'homosexualité comme signes de dégénérescence. Et jusque dans les années 1980, l’homosexualité figurait même dans les manuels psychiatriques comme une maladie.
Autrement dit, si vous avez honte de vos images intimes, ce n’est pas seulement à cause de la société : c’est aussi parce que la science a longtemps brandi un scalpel accusateur.
Aujourd’hui, le regard a changé
- L’OMS (CIM-11) et le DSM-5 distinguent fantasmes normaux (même tabous) et troubles paraphiliques (uniquement s’il y a souffrance ou absence de consentement).
Autrement dit : si vos fantasmes nourrissent votre désir sans faire de mal, vous n’êtes pas malades. Vous êtes humains.
- Justin Lehmiller (2018, 2023) a interrogé plus de 4 000 personnes : 97 % fantasment des choses "hors normes".
Autrement dit : si vous croyez être seuls, vous êtes déjà en train de nourrir un silence inutile. Ce que vous imaginez, des millions d’autres l’imaginent aussi.
- Christian Joyal (2015, 2017, 2022) a montré que les écarts entre hommes et femmes existent, mais sont minces. Les femmes parlent plus d’inconnu, de soumission, de transgression douce. Les hommes, de pluralité, de performance, d’exhibition. Mais 80 % des scénarios sont partagés.
Autrement dit : vos imaginaires ne sont pas en guerre, ils parlent la même langue avec des accents différents. Ce qui tue, c’est quand vous traduisez mal.
- Philippe Brenot (2012) parle de l’"imagination érotique" comme d’un carburant du désir.
Autrement dit : sans fantasme, le feu s’éteint. Le problème n’est pas d’en avoir, mais de les laisser mourir sous la cendre.
- Nathalie Bajos & Michel Bozon (2008, 2012) ont montré que la sexualité suit des scripts sociaux invisibles. Ce qui est tu n’est pas forcément ce qui est honteux, mais ce que la culture interdit de dire.
Autrement dit : si vos fantasmes vous semblent indicibles, c’est souvent parce que vous portez la voix de la société en vous, pas parce qu’ils sont réellement inavouables.
- Lehmiller (2021) a prouvé que les couples qui partagent au moins une partie de leurs fantasmes rapportent plus de satisfaction sexuelle et relationnelle.
Autrement dit : si vous restez dans le silence, vous vous privez d’un des leviers les plus puissants de complicité.
Et ce n’est pas qu’en Occident. En Afrique, des chercheurs décrivent des fantasmes de fécondité ou d’esprits, intégrés sans honte à l’imaginaire collectif. En Asie, au Japon, les scénarios codifiés (uniformes, hiérarchies) circulent ouvertement dans la culture populaire.
Autrement dit : le fantasme est universel, seul le tabou change de visage.
Pour nous résumer :
-
Fantasmer n’est pas une anomalie : c’est la norme humaine.
-
Ce n’est pas le fantasme qui détruit, c’est le silence qui l’entoure.
-
Ce n’est pas en vous taisant que vous protégerez votre couple, mais en apprenant à apprivoiser ce feu.

7. Apprivoiser le feu : comment en parler sans peur
Dans mon cabinet, les fantasmes ne sont pas des curiosités anecdotiques. Dans une thérapie de couple, ils déboulent, maladroits, brutaux, chargés de honte et de colère. Mon rôle : tenir le feu pour qu’il n’explose pas.
En séance ...
Ils s’assoient, chacun dans son fauteuil. Lui, les jambes qui bougent sans arrêt. Elle, bras croisés, mâchoire serrée. Le silence leur colle à la peau. C'est leur deuxième séance avec moi. Ce couple vient pour retrouver du désir et "pimenter" leur vie de couple. Lui a un fantasme très présent. Il a envie de le réaliser, même si ce n'est pas aussi clair que ce qu'il veut bien en dire ; son épouse vit très mal cette situation.
Je lance doucement :
- « Vous êtes venus pour parler de ce qui n’a jamais pu se dire. C’est le moment de tenter de le faire . »
Il souffle, détourne les yeux.
- « J’vais pas tourner autour… Je m'imagine souvent… avec deux femmes. Voilà. C’est con mais… c’est là. Ma femme et une autre femme. »
Il ricane, nerveux. Ses mains frottent son jean.
Elle explose, en larme :
- « 5 ans de mariage et je te suffis déjà plus. T’as besoin d’une pute en plus ? »
Il se redresse, rouge, mais reste en silence
Elle continue, blessée dans son amour-propre :
- « Ca fait 2 mois que tu me dis ça, t’as pas honte ?! J’suis quoi moi ? Une option ?! »
Leurs voix claquent. Le silence devient arme.
Je lève la main, ferme :
- « Vous n’êtes pas en train de parler du fantasme. Vous êtes en train de vous détruire. »
Le silence retombe. Ils respirent fort, mais se taisent.
Je me tourne vers lui.
- « Quand tu dis "deux femmes", qu’est-ce que tu cherches derrière ? »
Il hausse les épaules, bougon :
- « J’sais pas. C’est juste… que c’est là, j'ai vraiment envie, je le sens. »
Je ne lâche pas.
- « dans ce "je sais pas". Si tu devais mettre un mot, un seul. Ce serait lequel ?»
Il baisse les yeux. Ses épaules s’effondrent.
- « … Être désiré, vu, sentir que l'on me veut. Pas juste comme le type qui assure mais comme un homme. »
Sa voix casse.
Je me tourne alors vers elle.
— « Tu entends ? Il ne dit pas : tu ne me suffis pas. Il dit : je ne me sens plus vu comme un homme. Ce fantasme, c’est pas en l'état un projet d’infidélité. C’est un cri contre le rôle qui l’étouffe. »
Elle souffle, les larmes aux yeux. Elle entend une autre version... Pas une vérité. Non, juste une autre version.
Je résume :
— « Voilà l’écart. Lui : je veux exister comme homme désiré. Toi : je veux rester irremplaçable. Si vous n’entendez que l’image, vous vous détruisez. Si vous écoutez le besoin, vous vous rapprochez. »
Alors le silence se remplit. Cette fois, ils se regardent. Pas réconciliés, mais moins en guerre. On va poursuivre la séance ....
C’est ça, mon travail.
-
Arrêter l’explosion quand le fantasme devient arme.
-
Forcer à aller au besoin derrière l’image.
-
Traduire pour que chacun entende autre chose qu’une attaque.
-
Recadrer : socialement (le rôle viril qui écrase), sexuellement (le besoin de désir), symboliquement (le cercle de reconnaissance).
Un fantasme cru, lancé sans filtre, peut devenir un champ de ruines. Mais tenu, traduit, incarné, il devient une matière précieuse. Une braise qu’on peut nourrir, au lieu d’une grenade qui détruit.

8. Le fantasme comme miroir de l’humain désirant
Un fantasme n’est pas qu’un scénario mental. C’est une secousse du corps, une mémoire enfouie, une fissure dans le social, une ouverture sur le symbolique. C’est le langage le plus cru de ce que nous n’osons pas dire autrement.
1. Le fantasme comme langue de l’ombre et du corps
Quand un fantasme surgit, ce n’est pas seulement une idée : c’est une vague dans la chair : des joues qui rougissent, des mains tremblent, un ventre qui se noue, une gorge qui se serre.
Le corps parle avant les mots. Il dit la honte, le désir, la peur d’être jugé.
En thérapie, je m’arrête sur ces micro-signaux : "qu’est-ce que ton corps te dit en ce moment ?" Parce que souvent, le fantasme cache un besoin que le mental nie, mais que le corps sait.
2. Le fantasme comme miroir social et politique
Pourquoi tant de femmes fantasment la soumission ? Parce qu’elles portent le poids d’une société qui leur a appris à se contenir, à porter, à obéir. Le fantasme devient alors un espace paradoxal où l’abandon est enfin possible.
Pourquoi tant d’hommes fantasment la pluralité ? Parce qu’on leur a martelé que virilité = performance, puissance, conquêtes. Le fantasme devient alors un exutoire, une scène de validation impossible dans la réalité.
Ici, la sociologie (Bajos, Bozon, Illouz) le confirme : nos fantasmes ne sortent pas du néant. Ils rejouent des scripts invisibles, nourris par la culture, le patriarcat, la pornographie. Les nommer, c’est déjà commencer à s’en libérer.
3. Le fantasme comme mémoire transgénérationnelle
Certains fantasmes portent l’écho de blessures plus anciennes.
-
Une femme qui rêve d’être dominée ne fantasme pas toujours par "perversité" : parfois, c’est la mémoire d’une lignée de femmes contraintes qui traverse son corps.
-
Un homme qui rêve d’engrosser plusieurs femmes porte peut-être l’ombre d’ancêtres pour qui virilité = descendance nombreuse.
En thérapie, chercher et nommer ces héritages permet de les traverser. Le fantasme n’est plus un poids honteux, mais devient alors une trace à transformer.
4. Le fantasme comme rite initiatique et transpersonnel
Partager un fantasme, c’est se mettre plus nu que nu. C’est une véritable traversée initiatique au sein d'un couple :
-
Elle affronte la honte de son désir.
-
Il affronte la peur de ne pas suffire.
-
Ensemble, ils tiennent la peur de l’autre.
Et dans cet espace, quelque chose les dépasse. Jung l’aurait nommé archétype, Grof y verrait une ouverture transpersonnelle : le fantasme nous relie à l’inconscient collectif. C’est plus grand que nous, mais ça passe par nous.
En résumé :
-
Le fantasme est corporel → il fait rougir, trembler, jouir ou fuir.
-
Le fantasme est politique → il rejoue nos scripts sociaux et pornographiques.
-
Le fantasme est transgénérationnel → il porte les mémoires de nos lignées.
-
Le fantasme est alchimique → il peut être transmuté en confiance partagée.
-
Le fantasme est initiatique et transpersonnel → il ouvre la voie à un couple plus nu, plus vrai, plus libre.
Le fantasme n’est pas l’ennemi du couple. Il est sa matière première.
Soit il reste secret et mine le couple.
Soit il est accueilli, traversé, transfiguré… et il devient feu sacré du couple.

FAQ
1. Est-ce grave si je n’ose jamais parler de mes fantasmes ?
Non, ce n’est pas grave… mais c’est coûteux. Le silence crée souvent de la distance. Un fantasme tu peut se transformer en malaise, voire en ressentiment. Dans le couple, il vaut mieux apprendre à mettre des mots justes, même maladroits, que de laisser le non-dit corroder l’intimité.
2. Et si le fantasme de mon/ma partenaire me choque ?
C’est fréquent. Beaucoup entendent "je veux être dominée" ou "je rêve d’un plan à trois" comme un rejet personnel. Or, un fantasme n’est pas une demande de passage à l’acte : c’est une image symbolique qui cache un besoin (lâcher-prise, reconnaissance, mystère, etc.). Le travail thérapeutique consiste à traduire cette image pour qu’elle devienne compréhensible.
3. Les femmes et les hommes fantasment-ils vraiment différemment ?
Oui… et non. Les enquêtes montrent que les hommes évoquent plus la pluralité, les femmes plus la soumission. Mais 80 % des fantasmes sont partagés. Derrière les nuances, on retrouve les mêmes quêtes : être désiré, se sentir libre, oser l’inconnu.
4. Pourquoi mes fantasmes me semblent-ils honteux ?
Parce que notre société a longtemps pathologisé ce qui sortait du cadre reproductif. Et parce que nos fantasmes rejouent des scripts sociaux : la soumission féminine, la performance masculine. La honte vient moins du fantasme que du poids du patriarcat et de la pornographie qui façonnent nos imaginaires.
5. Dois-je absolument réaliser mes fantasmes pour être épanoui.e ?
Non. Le fantasme est d’abord un langage intérieur. Il peut rester imaginaire tout en nourrissant le désir. Le réaliser n’est ni une obligation, ni une garantie de satisfaction. Ce qui compte, c’est de comprendre ce qu’il exprime et d’en parler dans un cadre de confiance.
6. Que faire si mon fantasme est "trop différent" de celui de mon/ma partenaire ?
Il n’y a pas de fantasmes "compatibles" ou "incompatibles" en soi. L’enjeu n’est pas d’avoir les mêmes images, mais de trouver un terrain commun dans les besoins qu’elles révèlent. Parfois, une mise en scène symbolique suffit à apaiser le besoin, sans avoir à reproduire le scénario exact.
7. Les fantasmes peuvent-ils venir de mon histoire familiale ?
Oui. Beaucoup de fantasmes portent des traces transgénérationnelles. Une femme qui rêve d’être contrainte rejoue parfois l’histoire de ses mères qui n’avaient pas de choix. Un homme qui fantasme la fécondité multiple peut rejouer une lignée où la virilité se mesurait à la descendance. Les fantasmes parlent aussi de nos héritages invisibles.
8. Les fantasmes disparaissent-ils avec l’âge ?
Non. Ils évoluent. Avec le temps, ils se transforment : certains s’apaisent, d’autres apparaissent, souvent liés aux passages de vie (naissance, deuil, maladie, transitions hormonales). Les fantasmes sont une carte mouvante de nos besoins profonds.
9. Peut-on influencer ou transformer ses fantasmes ?
On ne les "efface" pas, mais on peut en transformer le sens. En thérapie, un fantasme honteux peut devenir une clé relationnelle. C’est le passage du brut (l’image qui fait peur) au symbolique (le besoin qui rapproche).
10. En quoi les fantasmes peuvent-ils enrichir le couple ?
Parce qu’ils sont une nudité plus radicale que la nudité du corps. Partager un fantasme, c’est se montrer vulnérable, risquer le regard de l’autre… et découvrir qu’on peut être tenu dans cet espace. Là réside leur puissance : non pas dans la performance, mais dans la complicité qu’ils créent.

Conclusion
Les recherches montrent que les fantasmes sont universels : 97 % des adultes en rapportent (Lehmiller, 2018). En France, Bajos et Bozon (2008) ont démontré qu’ils sont façonnés par les normes sociales (pluralité, domination, soumission, etc.). Christian Joyal (2015) rappelle que les différences entre hommes et femmes existent mais restent minimes : l’essentiel des scénarios est finalement partagé.
Dans mon cabinet, j'accompagne les couples à exprimer la façon dont leur corps porte les blessures et à traduire les besoins sous-jacents inhérents au fantasme. Dès lors, l’image cesse d’être une arme et devient alors une clé. Le travail thérapeutique ne consiste donc pas à censurer ni à réaliser à tout prix, mais de traduire.
- Traduire pour soi : pour ne pas confondre honte et pathologie.
- Traduire pour le couple : pour empêcher la guerre ; pour éviter que le silence ou la maladresse ne creusent la distance.
- Traduire enfin pour la symbolique : afin de transformer un scénario brut en un langage de besoin, parfois même en un rituel de confiance.
Et vous ?
-
Savez-vous ce que votre partenaire imagine quand il/elle se masturbe ? Et si ce n’était pas vous ?
-
Avez-vous déjà "réalisé" un fantasme par peur de perdre l’autre… puis senti la distance grandir malgré tout ?
-
Combien de fois avez-vous dit "je vais bien" alors que votre corps brûlait d’un imaginaire que vous n’osiez pas avouer ?
Si vos fantasmes vous brûlent en silence, venez les déposer dans un espace où ils ne seront ni jugés, ni ridiculisés, ni effacés. Ici, rien n’est trop honteux, trop étrange, trop tabou. Tout peut être dit, traversé, transformé.
En séance de couple (1h), je vous aide à traduire vos fantasmes en langage de lien, sans qu’ils vous détruisent. https://www.neosoi.fr/therapie-couple-sexotherapie-bordeaux-et-visio
En individuel (45 min), vous explorez vos images intimes et ce qu’elles révèlent de vos besoins enfouis.
https://www.neosoi.fr/psychotherapie-crise-de-couple-separation-perte-de-sens-et-eveil-interieur-bordeaux
Dans mes 2 parcours initiatiques ("Voyage au cœur de soi", "Traverser la blessure d’amour pour renaître au lien sacré"), vous traversez vos ombres pour renaître à une sexualité vivante et consciente.
Un fantasme est une vérité nue.
Soit vous la cachez et elle vous ronge.
Soit vous la jetez et elle vous brûle.
Soit vous osez la regarder ensemble… et alors elle devient lumière.
Bibliographie
-
American Psychiatric Association. (2013). DSM-5 : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (5ᵉ éd., trad. française). Paris : Elsevier Masson.
-
Bajos, N., & Bozon, M. (2008). Enquête sur la sexualité en France : pratiques, genre et santé. Paris : La Découverte.
-
Bozon, M. (2025). Sociologie de la sexualité. Paris. Armand Colin
-
Brenot, P. (2012). Inventer le couple. Paris : Les Arènes.
-
Cyrulnik, B. (2001). Les vilains petits canards. Paris : Odile Jacob.
-
de Sutter, P., & Solano, C. (2011). Les hommes, le sexe et l’amour : Ce que les hommes veulent vraiment. Paris : Eyrolles.
-
de Sutter, P., & Solano, C. (2012). Les femmes, le sexe et l’amour : Ce que les femmes veulent vraiment. Paris : Eyrolles.
-
Foucault, M. (1976). La volonté de savoir. Paris : Gallimard.
-
Hanot, N. (2020). Les blessures d’attachement : Les comprendre et les dépasser. Bruxelles : Éditions L’Investigateur.
-
Illouz, E. (2006). Les sentiments du capitalisme. Paris : Seuil.
-
Joyal, C. C., Cossette, A., & Lapierre, V. (2015). What exactly is an unusual sexual fantasy? Journal of Sexual Medicine, 12(2), 328-340. https://academic.oup.com/jsm/article-abstract/12/2/328/6980029?redirectedFrom=fulltext
-
Lehmiller, J. J. (2018). Tell me what you want: The science of sexual desire and how it can help you improve your sex life. New York, NY : Da Capo Press.
-
Nagoski, E. (2015). Come As You Are: The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life. New York : Simon & Schuster.
(Trad. française : Tout sur le désir féminin [2020], Paris : Marabout). -
Organisation mondiale de la santé. (2019). Classification internationale des maladies, 11ᵉ révision (CIM-11). Genève : OMS.
-
Perel, E. (2017). The State of Affairs: Rethinking Infidelity. New York : Harper.
(Trad. française : Les chemins de l’infidélité [2020], Paris : Robert Laffont).

NeoSoi - Dr Céline BERCION - psychologue sociale et systémique, psychlthérapie, thérapie de couple et sexothérapie - Bordeaux et visio
36 Avenue Roger Cohé
33600
Pessac
France
Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités

