Quand l’un des deux veut "vivre sa vie" : comprendre ce qui se joue vraiment dans le couple et traverser ce tournant sans casser la famille
Il existe des phrases qui peuvent faire basculer tout un couple. Je crois que l'un des plus redoutée est probablement celle-ci : "je veux vivre ma vie".
Beaucoup y entendent un abandon. En réalité, cette phrase révèle presque toujours une crise identitaire, un étouffement du désir, une fatigue du rôle ou une rupture entre la personne et son propre corps. Dans ma pratique de psychologue sociale et systémique, thérapeute de couple et sexothérapeute, je constate que c’est l’un des signaux les plus puissants d’un système qui arrive à saturation.
Quand quelqu’un (ou un couple) arrive dans mon cabinet et que l'un des deux dit "je veux vivre ma vie", il parle rarement de rupture (même si dans les faits c'est ce qui est annoncé comme tel). Il parle de survie. Il parle d’un besoin d’air, d’un besoin de se retrouver, de sortir de la suradaptation affective, de la charge mentale, de l’effacement du féminin ou du masculin vivant.
Mais celui qui reçoit cette phrase y entend souvent : "je ne veux plus de toi".
Ce sont deux réalités qui se percutent à la vitesse d’un trauma.
Et c’est là que la crise de couple explose : attachement réactivé, peur de perdre, modèles parentaux qui se réveillent, équilibre familial menacé, la honte de ne pas avoir suffi. Le choc individuel devient alors un choc systémique. C’est d'abord le système couple, puis le système famille, qui vacillent.
Et notre époque ajoute une tension encore plus forte à tout cela : comment vivre sa vie sans détruire la famille ? Comment écouter l’appel intérieur sans casser le lien ?
Cet article explore précisément ce qui se joue vraiment dans le couple quand cette phrase surgit et comment traverser ce tournant sans casser la famille, en tenant compte du corps, du désir, des transmissions familiales, de la systémie et de la vie réelle.
Parce que parfois, "vivre sa vie" est moins une rupture qu’une chance de renaître - seul ou ensemble.

1 - Que signifie réellement "Je veux vivre ma vie" ?
Lorsqu’un partenaire prononce "je veux vivre ma vie", l’effet est immédiat : le couple bascule dans une zone de turbulence. Certes, ces mots semblent annoncer une rupture ; et pourtant ... les cliniciens spécialistes de l’attachement (notamment Nicole et Antoine Guédeney) rappellent que ce type de phrase est d’abord et avant tout un marqueur de détresse interne, bien plus qu’une volonté réelle de quitter l’autre.
Ainsi, pour saisir ce qui se joue réellement, il faut articuler trois dimensions : le vécu subjectif, la réaction d’attachement et le mouvement systémique que cette phrase enclenche.
Comme le souligne Catherine Audibert dans ses travaux sur les blessures d’attachement (Les blessures d’attachement, Payot), les crises conjugales ne sont pas uniquement des crises du lien : ce sont aussi des crises du rapport à soi dans le lien.
Autrement dit, lorsque quelqu’un dit "je veux vivre ma vie", il évoque souvent un écart croissant entre la personne qu’il est devenue et la personne qu’il aspire à redevenir.
1.1. Une phrase qui dit "j’étouffe", alors que l’autre entend "tu m’abandonnes"
En effet, dans de nombreux cas cliniques décrits par Marie-Frédérique Bacqué, les phrases radicales émergent lorsque la personne a dépassé ses capacités internes d’adaptation : charge mentale élevée, fatigue émotionnelle, sentiment d’invisibilité relationnelle, etc. Certes, il ne s’agit pas toujours de suradaptation chronique ; cependant, on observe très souvent une tension intérieure entre loyauté au couple et loyauté envers soi-même.
Alors, quand la "fameuse" phrase surgit, ce que la personne veut dire est généralement :
-
"Je ne me reconnais plus dans le rôle que j’occupe"
-
"Je manque d’air"
-
"Je n’ai plus d’espace intérieur"
Or, comme l’explique Eva Illouz, nos scripts relationnels contemporains produisent une confusion fréquente : quand l’un parle de soi, l’autre entend souvent une attaque contre le lien. De ce fait, la phrase résonne comme une rupture alors qu’elle exprime souvent une demande de transformation.
1.2. Le rôle central du corps et du désir : un baromètre relationnel sous-estimé
Cependant, il serait réducteur d’y voir seulement un phénomène psychologique. Les travaux de sexologie francophone —(Cf. Philippe Brenot, Claude Crépault, Pascal Hachet) montrent que le corps réagit bien avant les mots. Ainsi, lorsque quelqu’un prononce "je veux vivre ma vie", c’est souvent après une période marquée par :
-
un désir affaibli,
-
une énergie corporelle diminuée,
-
une dissociation entre rôle social et ressenti intérieur,
-
une impression de “ne plus habiter son corps”.
De ce fait, comme le décrit bien Crépault, la baisse du désir ne signale pas uniquement une difficulté sexuelle, mais surtout un effondrement de la motivation interne.
Ainsi, la phrase "vivre ma vie" devient le langage verbal d’un corps qui, depuis longtemps, tente de dire : "je n’ai plus de place".

1.3. Le choc d’attachement : la tempête émotionnelle immédiate
Or, si la phrase déclenche une réaction aussi intense, ce n’est pas tant en raison de son contenu que de ce qu’elle active. Les auteurs de l’attachement (Cf. Guédeney, Audibert, Hanot) montrent que toute menace perçue sur le lien ravive les mémoires d’abandon, de rejet et de peur de la perte. Nous croyons décider librement ; cependant, nos réactions conjugales sont intimement liées à la manière dont nous avons été attachés, séparés, sécurisés ou insécurisés dans l’enfance.
Dès lors, lorsqu’un partenaire prononce cette phrase, ce n’est pas uniquement un individu qui parle : c’est toute son histoire qui s’exprime et qui entre en friction avec celle de l’autre.
Alors certes, le partenaire parle d’un besoin interne ; cependant, l’autre entend très souvent une mise en danger de l’équilibre familial. CQFD
Ainsi, la crise ne commence pas dans la réalité objective,
mais dans l’activation des représentations internes du lien.
1.4. Une phrase qui signale une saturation systémique, pas une fin du couple
Ici, la lecture systémique (Cf. Minuchin et les approches structurelles) offre une clé essentielle. Lorsque l’un dit "je veux vivre ma vie", il ne dit pas : "je veux me séparer". Il dit : → "la configuration actuelle ne me permet plus d’exister".
La phrase révèle ainsi une saturation structurelle du couple : répartition des rôles, charge mentale, non-réciprocité du soin, effondrement du désir, asymétrie affective. Ce n’est pas l’amour qui vacille. C’est la forme du lien qui devient trop étroite.
Et, comme le rappelle Guy Corneau :
"on ne quitte pas l’autre. On quitte la version de soi que l’on était devenu avec l’autre".
Cette phrase devient alors non pas une rupture, mais un point d’inflexion, une invitation à revoir les modèles parentaux, les script sociaux et la façon dont le couple s’est structuré.

2. Les modèles parentaux et les scripts sociaux : comment notre histoire oriente (à notre insu) le sens de "vivre sa vie"
Lorsque l’un des partenaires dit "je veux vivre ma vie", il réagit rarement uniquement à la situation présente. En réalité, cette phrase s’inscrit dans une chaîne de tout un tas de déterminants invisibles : les modèles parentaux internalisés, les blessures d’attachement, les scripts sociaux assimilés, et les normes culturelles qui façonnent nos attentes conjugales.
Ainsi, ce moment n’est jamais seulement personnel : il est aussi transgénérationnel, social et systémique.
Par ailleurs, les recherches d’Eva Illouz sur la modernité affective montrent que nos attentes amoureuses sont désormais composées d’injonctions contradictoires : être autonome et profondément lié, être soi-même sans décevoir, réussir sa vie individuelle tout en préservant sa famille. Autrement dit, nos scripts sociaux amplifient ce qui, déjà, résonne dans notre histoire intime.
2.1. Comment les modèles parentaux façonnent notre seuil de tolérance dans la relation
En clinique systémique, on observe régulièrement trois grandes empreintes parentales, qui sont chacune traversée par ses propres tensions internes. Ainsi, la manière dont chacun réagit à une crise de couple (et notamment à la phrase "je veux vivre ma vie") dépend largement de ces empreintes.
1. Le parent sacrifié : l’héritage du renoncement
Lorsque l’on a grandi auprès d’un parent qui s’est effacé pour la famille, on développe souvent un rapport ambivalent au lien. D’un côté, on veut éviter de reproduire cet effacement ; de l’autre, on en porte inconsciemment la loyauté.
Ainsi, pour ces personnes, dire "vivre ma vie" est moins une fuite qu’une tentative de rompre un cycle familial de sacrifices silencieux.
2. Le parent absent ou libertaire : l’héritage de la distance
À l’inverse, lorsque l’un des parents suivait sa propre trajectoire, l’enfant grandit avec un modèle où la liberté est perçue comme un mouvement naturel. Toutefois, cette liberté s’accompagne souvent d’une peur d’abandon, comme l’ont montré Catherine Audibert et Marie-Frédérique Bacqué dans leurs travaux sur l’insécurité affective.
De ce fait, adulte, "vivre sa vie" peut émerger comme une réaction automatique face à la saturation relationnelle.
3. Le parent fusionnel : l’héritage de l’enveloppement
Lorsque l’enfant a grandi sous l’emprise d’un parent trop proche, la distance devient vitale. Ainsi, ces personnes perçoivent rapidement le couple comme un espace de risque : celui de se dissoudre dans l’autre. Dire "je veux vivre ma vie" signifie alors "je veux rester moi dans la relation, même si ça doit coûter la relation".

2.2. Les scripts sociaux : pourquoi notre époque amplifie le besoin de "vivre sa vie"
Cependant, il serait incomplet d’expliquer la crise uniquement par l’histoire familiale. En effet, comme le souligne Illouz, la modernité affective impose aux individus une double exigence :
-
s’accomplir personnellement,
-
réussir affectivement et familialement.
Ainsi, nos sociétés valorisent simultanément l’autonomie et la stabilité conjugale. Cette tension crée une pression constante dans le couple, particulièrement quand la charge mentale ou le déséquilibre des rôles s’ajoutent au quotidien.
Par ailleurs, les travaux de Pascale Molinier sur l’invisibilité du care montrent que les femmes (et parfois certains hommes) portent encore une grande partie de la charge affective, émotionnelle et organisationnelle. Dès lors, la phrase "je veux vivre ma vie" apparaît fréquemment lorsque le poids du lien dépasse les ressources disponibles.
Autrement dit : notre époque produit des couples où l’équilibre familial repose souvent sur une seule personne.
Et celle-ci finit par s’épuiser.
2.3. Loyautés invisibles : quand le passé déborde sur le présent
Dès lors, ce moment de crise doit être compris comme une rencontre entre :
-
une histoire personnelle,
-
des attentes culturelles,
-
un système relationnel,
-
et un modèle familial sous-jacent.
Comme le rappelle Marie-Frédérique Bacqué, les crises identitaires ne sont pas des signes de désamour, mais des signes de disjonction interne entre ce que l’on vit et ce que l’on peut continuer à porter. "Je veux vivre ma vie” signifie alors : "je n’ai plus assez d’espace pour incarner ce rôle familial".
Ainsi, loin d’être une rupture, cette phrase indique que le système couple-famille arrive au bout d’une forme et qu’une réorganisation profonde devient nécessaire. Et parfois au prix du couple conjugal.

3. Le mouvement systémique : quand l’un bouge, tout le système couple-famille doit se réorganiser
L’erreur serait de croire qu’il s’agit d’un simple mouvement individuel. En réalité, comme l’avaient déjà montré Bateson et plus tard Minuchin, un couple fonctionne comme un système vivant, où chaque élément influence l’autre en permanence.
Ainsi, dès qu’un membre du système modifie sa position interne, c’est tout l’équilibre relationnel (conjugal et familial) qui doit s’ajuster. Autrement dit : "je veux vivre ma vie" n’ouvre pas sur une crise personnelle, mais bien sur une crise structurelle.
Certes, celui qui parle exprime un besoin intime ; toutefois, ce besoin agit comme un levier systémique profond. Et par ailleurs, ce mouvement vient déstabiliser la fonction que chacun occupait jusque-là dans la dynamique relationnelle.
3.1. Quand l’un bouge, le système se met en tension : effet domino et rétroactions
En thérapie systémique, on observe que chaque système cherche avant tout à maintenir une forme d’homéostasie. Ainsi, même si cette homéostasie est douloureuse ou déséquilibrée, elle est rassurante parce qu’elle est familière. Dès lors, lorsque l’un des partenaires annonce un besoin radical (comme "je veux vivre ma vie","je veux plus étouffe", etc.) le système entier interprète ce geste comme une perturbation majeure.
Pourquoi ? Parce que ce mouvement provoque des rétroactions immédiates :
-
rétroactions négatives (tentatives de retour à l’équilibre) :
minimisation, rationalisation, promesses de changement, contrôle, anxiété, accusations -
rétroactions positives (amplification de la crise) :
conflits, retrait, escalade émotionnelle, jalousie structurelle, fuite en avant, ruptures de communication
De ce fait, chacun réagit non pas à l’autre, mais à la perte subite de repères relationnels.
Ainsi, le système se tend, s’agite ou se rigidifie. Le partenaire qui ne voulait changer "que sa vie intérieure" se retrouve alors au centre d’une réorganisation globale, souvent inattendue et véritablement déroutante.
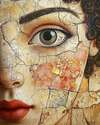
3.2. L’effet sur les rôles, les places et les coalitions implicites
Par ailleurs, lorsqu’un partenaire bouge, son geste met en lumière l’équilibre des rôles et des places au sein du couple. Comme l’ont analysé Catherine Audibert et Nicole Guédeney, la structure conjugale repose souvent sur :
-
des rôles implicites (celui qui soutient, celui qui rassure, celui qui porte le désir, celui qui fait tenir la famille),
-
des coalitions invisibles (un parent avec un enfant, un parent seul avec la charge mentale),
-
des alliances silencieuses (celui qui apaise, celui qui évite, celui qui contient les émotions).
Alors, lorsque l’un annonce "je veux vivre ma vie", il annonce aussi qu’il ne tiendra plus son rôle de la même manière. Dès lors, l’autre perd non seulement un partenaire, mais aussi un pilier implicite du système.
Et ce changement crée souvent un cycle d’escalade : → un mouvement d’autonomie → une réaction de peur → plus de retrait ou plus de contrôle → amplification du besoin d’autonomie.
Autrement dit : le système entre en rétroaction circulaire.
3.3. Le corps dans la systémie : capteur, révélateur, résistant
Cependant, il serait incomplet de lire ce mouvement uniquement comme une dynamique relationnelle. Le corps y occupe une place centrale, comme le soulignent Brenot, Crépault et Bacqué dans leurs travaux. En effet, avant même que la phrase soit prononcée, le corps signale de nombreuses manifestations :
-
une fatigue profonde,
-
un effondrement du désir,
-
un retrait sensoriel,
-
une perte de pulsation,
-
une saturation du système nerveux,
-
un effacement identitaire.
Ainsi, lorsque le partenaire exprime son besoin, ce n’est pas simplement une demande psychologique : c’est un appel du corps. Celui-ci refuse de continuer dans la forme actuelle du lien.
Par ailleurs, le corps de l’autre réagit aussi immédiatement : accélération du rythme cardiaque, panique, contraction thoracique, mécanismes de défense. Ces réactions somatiques sont bien décrites dans les approches polyvagales et corroborées par les observations cliniques d’Audibert et Guédeney.
Dès lors, je dirais volontiers que la crise systémique est aussi une crise corporelle.

3.4. Les enfants : amplificateurs, révélateurs et stabilisateurs
Il est impossible de comprendre la crise sans intégrer la dynamique familiale. Comme le rappelle Bacqué, les enfants ne sont pas des spectateurs : ils participent au système émotionnel. Ainsi, dans ces moments, ils peuvent :
-
amplifier la tension (anxiété, irritabilité, troubles du sommeil),
-
stabiliser le système (attachement, besoin d’un parent stable),
-
révéler le déséquilibre (difficultés scolaires, hypervigilance).
Autrement dit : la crise conjugale devient une crise familiale. Et chacun, consciemment ou non, tente de rétablir une forme d’équilibre.
3.5. La véritable question systémique : la forme est-elle devenue trop étroite ?
Toutes ces rétroactions, ces tensions, ces résistances convergent vers une question centrale : la forme actuelle du couple est-elle devenue trop étroite pour au moins un des deux partenaires ?
En effet, comme le montre Minuchin, on ne quitte pas nécessairement le système : on quitte une organisation du système. Ainsi, celui qui dit "vivre ma vie" ne cherche pas forcément à partir ; il cherche à rétablir une cohérence interne que la structure actuelle ne permet plus.
En d’autres termes : la crise n’est pas forcément une fin. Elle est avant tout un appel à réorganisation, une invitation à agrandir l’espace psychique, symbolique et relationnel du couple-famille. Et ensuite, tout dépend de ce qui est encore à l'oeuvre dans le lien pour que le couple conjugal puisse se renouveler. Ou pas.
Ainsi, cet appel à "vivre sa vie" n’est ni un caprice, ni une prophétie de rupture. C’est surtout le signe qu’un partenaire ne peut plus tenir la place qui lui a été assignée, consciemment ou non. Dès lors, le système doit bouger, changer de forme, redéfinir ses frontières, ses places, son souffle.
Et c’est précisément là que se joue la suite : dans le corps, le désir, la vérité intérieure et la possibilité d’une renaissance du lien ou d’une renaissance individuelle.

4. Le corps, le désir et la vérité du lien : comment reprendre sa place sans casser la famille
Lorsque l’un des partenaires dit "je veux vivre ma vie", il touche non seulement le cœur du couple, mais aussi son corps, son désir, et la matrice identitaire de chacun. En d’autres termes, la sortie de crise n’est pas qu’une affaire de mots : elle se joue dans la peau, dans la respiration, dans la pulsation, dans ce que Brenot appelle "la signature corporelle du lien".
Ainsi, pour traverser cette crise de couple sans détruire l’équilibre familial, il faut comprendre que la transformation se joue simultanément dans trois espaces : le corps, le désir et la place.
Cela signifie que l’on ne reconstruit pas un couple seulement avec des explications, mais avec une réorganisation vivante et incarnée.
4.1. Le corps : premier témoin, premier avertissement, premier terrain de réparation
En effet, comme nous venons de le voir et comme l’ont montré les travaux de Philippe Brenot et Claude Crépault, le corps est souvent le premier à signaler que la forme de la relation ne fonctionne plus.
Par ailleurs, dans les couples en crise, le corps raconte toujours quelque chose avant même la parole :
-
respiration bloquée,
-
tension dans la mâchoire,
-
ventre contracté,
-
perte de libido,
-
fatigue nerveuse,
-
effacement sensoriel.
Je me souviens d’une séance où une femme, après un long silence, a simplement déclaré : « s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que mon corps ne veut plus". Elle n’accusait pas son mari. Elle constatait. Son souffle était court, son bassin figé, ses épaules repliées. Autrement dit : son corps était saturé du rôle, pas du lien.
Ainsi, avant de reconstruire quoi que ce soit, le premier travail en thérapie de couple et en sexothérapie consiste à rouvrir l’espace intérieur. Cela passe par :
-
des pratiques de respiration,
-
des temps de retrait réparateur,
-
une diminution réelle de la charge mentale,
-
des moments où le corps peut se déposer,
-
la permission de ressentir sans "tenir" pour tout le système.
En résumé :
Le corps doit redevenir un lieu où l’on se retrouve, avant de redevenir un lieu où l’on se rejoint.

4.2. Le désir : boussole intime et miroir de la relation
Cependant, le corps ne dit pas tout. Le désir, lui, révèle le sens.
En sexothérapie, le désir n’est jamais qu’une question "sexuelle" : il est une mesure de la vitalité, de la circulation de l’énergie entre deux êtres, de la place que chacun occupe. Ainsi, lorsque l’un dit "je ne me désire plus ici", il dit aussi :
-
je ne me reconnais plus,
-
je ne me sens plus sujet,
-
je ne respire plus dans notre dynamique,
-
je porte trop.
Selon Crépault, la libido s’effondre non pas par manque d’amour, mais par effondrement motivationnel, souvent lié à une surcharge émotionnelle, parentale ou symbolique.
Par ailleurs, la société impose aujourd’hui une injonction au "désir spontané", alors que précisément la charge mentale (affective, sexuelle, familiale) tue la spontanéité. C’est ce que montrent les travaux de Pascale Molinier sur l’invisibilité du care : celui qui porte la relation porte aussi la perte du désir.
Ainsi, le désir devient une boussole :
-
s’il revient, il indique une réouverture du vivant,
-
s’il ne revient pas, il indique une vérité intérieure à respecter.
4.3. La place : de la fonction assignée à l’espace choisi
Toutefois, aucune transformation durable n’est possible sans revisiter la place de chacun dans le système couple-famille. En effet, comme le rappelle Catherine Audibert, les crises ne surviennent pas parce que les gens ne s’aiment plus, mais parce que la place qu’ils occupent ne leur permet plus d’être vivants.
Ainsi, l’un porte trop, l’autre pas assez ; l’un régule le lien, l’autre l’habite ; l’un contient tout, l’autre s’y réfugie. Le système se rigidifie.
Cela signifie que la reconstruction implique :
-
d’assouplir les rôles,
-
de renégocier la charge mentale,
-
d’oser dire non,
-
d’oser demander,
-
d’arrêter les surinvestissements silencieux,
-
d’arrêter l’injustice affective où un seul porte le lien.
En d’autres termes : on ne sauve pas un couple en demandant à l’autre d’être plus, mais en reprenant chacun la place qui nous rend vivants.

4.4. La vérité relationnelle : courage, vulnérabilité et parole incarnée
Par ailleurs, aucune réorganisation n’est possible sans vérité. Toutefois, la vérité ne se dit pas contre l’autre, mais depuis soi. Il s’agit de dire :
-
"je suis épuisé",
-
"mon corps se retire",
-
"je ne veux plus porter seul",
-
"j’ai besoin de reprendre ma vie intérieure",
-
"j’étouffe dans notre forme actuelle".
Comme le souligne Eva Illouz, les couples contemporains échouent non par manque d’amour, mais par manque de discours incarné. La vérité relationnelle doit être dite avec courage, mais aussi avec tendresse : une parole qui dit "voici où j’en suis" et non "voici ce que tu m’as fait". Et c’est précisément cette parole qui rouvre la possibilité d’un lien.
4.5. Protéger la famille : un espace à trois niveaux
Enfin, traverser une crise sans casser la famille implique un travail simultané sur trois niveaux :
1. L’individu : restaurer la continuité interne
Prendre soin du corps, du désir, de l’identité.
Réduire la surcharge.
Renouer avec la pulsation.
2. Le couple : réinventer l’alliance
Clarifier la place.
Rééquilibrer les responsabilités.
Retrouver une circulation vivante de la parole et du désir.
3. La famille : offrir un espace stable
Sécuriser les enfants.
Expliquer simplement sans surcharger.
Éviter la triangulation.
Restaurer des routines fiables.
Ainsi, il ne s’agit pas de choisir entre soi, le couple ou la famille :
il s’agit d’ouvrir une nouvelle forme où chacun peut respirer.
En définitive, cette déclaration sur le mode "je veux vivre ma vie" est rarement une fuite : c’est surtout un appel à la renaissance. Et cette renaissance peut être individuelle et/ou conjugale.
Cependant, dans les deux cas, elle exige :
-
du courage,
-
du corps,
-
du désir,
-
de la vérité,
-
et une réorganisation sensible du système.
Autrement dit : la crise ne détruit pas le couple.
Elle détruit seulement ce qui n’était plus vivant, pour ouvrir la possibilité d’un lien plus juste, plus conscient, plus incarné.

5. Comment en parler aux enfants : vérité, sécurité et parentalité conjointe
Lorsque l’un des partenaires veut partir pour "vivre sa vie", la crise qui s’ouvre n’est donc pas seulement conjugale : elle devient immédiatement familiale. En effet, comme l’ont montré Nicole et Antoine Guédeney, les enfants captent avant tout le climat émotionnel, bien plus que les mots prononcés. Ainsi, même si les parents ne disent rien, les enfants sentent tout : les tensions corporelles, les silences inhabituels, les regards évités, les gestes précipités.
Autrement dit : les enfants perçoivent la crise dans leur corps, avant même de l’entendre avec leurs oreilles.
5.1. Ce que vivent les enfants : perception corporelle et climat affectif
Les travaux de Guédeney et Cyrulnik le montrent clairement : un enfant ne lit pas la situation avec sa tête, mais avec son système nerveux.
Ainsi, l'enfant ressent immédiatement :
-
un changement dans la respiration du parent,
-
une variation du ton de voix,
-
une crispation dans les épaules,
-
une agitation inhabituelle,
-
une fatigue émotionnelle,
-
un effondrement de la disponibilité.
Par ailleurs, dans les familles en crise de couple, les enfants absorbent souvent les émotions systémiques sous forme de symptômes :
-
troubles du sommeil,
-
irritabilité,
-
régressions,
-
hypervigilance,
-
anxiété de séparation.
Comme l’explique Catherine Audibert, l’enfant devient parfois l’éponge émotionnelle du système, afin de stabiliser un couple qui n’arrive plus à se contenir.
En d’autres termes : parler aux enfants n’est jamais un danger ; se taire, parfois oui.
5.2. Comment en parler : vérité simple, sécurité émotionnelle, parentalité conjointe
Pour préserver l’équilibre familial, trois principes structurent une communication saine :
1. La vérité adaptée
Les enfants n’ont pas besoin de détails.
Ils ont besoin d’une vérité sobre, cohérente, répétée de la même manière par les deux parents.
Par exemple :
-
"Papa et maman traversent une période compliquée entre eux."
-
"Nous réfléchissons à comment aller mieux"
-
"Ce n’est pas de ta faute"
Autrement dit : dire peu, mais dire vrai.
2. La sécurité affective
Comme le montrent les travaux de l’attachement, la sécurité d’un enfant dépend moins du contenu que de l’état interne du parent.
Ainsi, il est essentiel de transmettre :
-
"Nous t’aimons"
-
"Nous restons tes parents"
-
"Tu peux continuer à jouer"
Une parole simple, un ton doux, une cohérence émotionnelle valent davantage qu’un long discours.
3. La parentalité conjointe
Même si le couple est en crise, les enfants doivent percevoir que les parents restent une équipe.
Cela implique :
-
un message commun,
-
des décisions prises ensemble,
-
l’absence de contradictions,
-
l’absence de compétition parentale.
Comme le rappelle Minuchin, l’unité parentale est un régulateur majeur de l’équilibre familial.

5.3. Ce qu’il ne faut jamais dire : la liste rouge
Certaines paroles fragilisent profondément l’enfant et doivent être absolument évitées :
-
❌ "Je suis malheureux à cause de papa/maman"
-
❌ "Il / elle veut vivre sa vie"
-
❌ "Tu me comprends, toi"
-
❌ "Tu vas devoir être fort pour moi"
-
❌ "Ce qui se passe est entre nous deux"
Ces phrases créent des triangulations nocives : l’enfant devient alors support émotionnel du parent, rôle auquel il n’est jamais destiné.
5.4. Styles d’attachement et erreurs de communication
Parce que tous les parents ne transmettent pas la crise de la même manière...
• Parent anxieux
Parle trop, détaille trop, submerge l’enfant d’émotions.
➜ À réguler : garder la parole courte, respirer avant de parler.
• Parent évitant
Ne dit rien, minimise, fuit les conversations.
➜ À travailler : nommer l’essentiel, même en deux phrases.
• Parent désorganisé ou chaotique
Dit trop, trop vite, trop fort.
➜ À sécuriser : préparer la conversation avant, être accompagné.
En résumé : la vérité doit être ajustée au style du parent, pas au style de la crise.
5.6. Stabiliser l’équilibre familial pendant la crise
Pour maintenir la sécurité émotionnelle, il est essentiel de stabiliser :
-
les routines,
-
les horaires,
-
les rituels,
-
les temps de partage,
-
le rythme scolaire,
-
les espaces de jeu.
En pratique : le quotidien protège l’enfant autant que la parole.
En définitive, parler aux enfants ne fragilise pas la famille. Cela la renforce.
Parce que les enfants ne demandent pas des parents parfaits, mais des parents vrais, régulés, présents.

FAQ
1. Pourquoi mon partenaire dit-il soudainement qu’il veut "vivre sa vie" ?
Parce qu’il arrive au bout d’une forme relationnelle qui ne lui permet plus de respirer. En résumé, ce n’est pas l’amour qui lâche : c’est la structure du couple qui devient trop étroite.
Autrement dit : il ne dit pas "je veux partir", mais "je ne peux plus continuer comme ça".
2. Est-ce que ça veut dire que la relation est terminée ?
Pas forcément.
Pour beaucoup, " vouloir vivre sa vie" signifie :
-
sortir d’une suradaptation,
-
retrouver une cohérence intérieure,
-
reprendre son axe,
-
corriger une injustice affective,
-
remettre le corps dans le lien.
En d’autres termes : c’est souvent une demande de transformation, pas une annonce de rupture.
3. Pourquoi moi, je veux réparer… et lui/elle veut prendre de la distance voire se séparer ?
Parce que vous n’êtes pas au même stade de saturation. Le partenaire qui veut "vivre sa vie" est souvent épuisé, avec un système nerveux contracté et un désir effondré. Celui qui veut réparer est encore en "mode lien".
En pratique : vous ne partez pas du même état intérieur. C’est normal ; mais ça demande d’être accompagné.
4. Comment réagir quand l’autre annonce ça ?
Concrètement :
-
Respirez.
-
Ne paniquez pas (la panique détruit 50% des couples qui pourraient se transformer).
-
Ne cherchez pas à convaincre, mais à comprendre ce qui sature.
-
Ouvrez le dialogue sur la forme du lien, pas sur “qui a raison”.
Autrement dit : gardez le lien ouvert, même si vous n’êtes pas d’accord.
5. Comment savoir si c’est une crise de forme… ou une vraie séparation ?
Observez trois indicateurs essentiels :
-
Le corps : retrait, épuisement, perte de pulsation.
-
Le désir : effondré, blessé ou simplement étouffé.
-
La place : rôle injuste, charge mentale trop lourde, absence de reconnaissance.
Quand ces trois dimensions sont travaillées, la relation peut renaître.
6. Et si c’est moi qui ne veux pas me séparer ?
En résumé : vous n’êtes pas impuissant. Votre posture fait partie du système. Ce que vous faites maintenant influence la trajectoire de la relation.
Pour ne pas aggraver la crise :
-
évitez les supplications,
-
évitez les promesses irréalistes,
-
évitez les accusations,
-
évitez de “garder” l’autre par la peur.
Ce qui aide vraiment :
-
l’écoute,
-
la vérité,
-
le respect du mouvement intérieur de l’autre,
-
et une proposition de réorganisation, pas de sauvetage.
7. Comment préserver les enfants pendant cette crise ?
Dites peu, mais dites vrai. Les enfants ont surtout besoin de :
-
sécurité affective,
-
vérité simple,
-
routines stables,
-
cohérence parentale.
Ce qu’il faut retenir : le silence blesse plus que la vérité adaptée.
8. Faut-il dire la vérité aux enfants ?
Oui. Toujours. Mais une vérité ajustée, sans détails inutiles.
Les enfants perçoivent la crise dans leur corps ; ne rien dire crée de l’angoisse.
Phrase sûre et efficace : "on traverse une période difficile, mais tu n’y es pour rien et on reste tes parents".
9. Comment leur parler sans les inquiéter ?
En pratique :
-
Parlez lentement,
-
restez dans le concret,
-
évitez les scénarios futurs,
-
adoptez une posture corporelle régulée (voix calme, respiration basse).
Une seule règle : sécuriser, pas se confier.

10. Et si l'un veut se séparer … mais pas l’autre ?
C’est une situation fréquente. Elle crée une asymétrie douloureuse, mais pas insurmontable. Ce qu’il faut éviter :
-
la pression,
-
le drama,
-
les ultimatums,
-
le sacrifice désespéré.
Ce qu’il faut privilégier :
-
ralentir,
-
clarifier,
-
protéger les enfants,
-
comprendre ce que dit la crise,
-
poser un cadre temporaire de réflexion,
-
consulter.
Autrement dit : ouvrir un espace où chacun peut se dire sans casser la famille.
11. Comment éviter que l’enfant devienne le "confident" d’un parent ?
C’est crucial. Dès que l’enfant sert de soutien, il devient symptôme du système (Minuchin).
À éviter absolument :
-
"Tu comprends maman, toi"
-
"Je te dis ça parce que tu es mature"
-
"Tu dois être fort pour moi"
À faire :
-
"Entre adultes, on va trouver comment avancer"
-
"Ta seule mission, c’est d’être un enfant"
12. Pourquoi je porte toujours la charge émotionnelle ?
Parce que le système vous l’a assignée. Les rôles se sont rigidifiés. Et votre corps en porte les traces : tension, surcharge mentale, épuisement affectif, désir en chute.
En d’autres termes : vous ne portez pas mal. Vous portez trop.
13. Comment reconstruire le lien après cette annonce ?
Concrètement :
-
remettre le corps dans la relation,
-
rouvrir la vérité,
-
reposer les règles du couple,
-
restaurer la circulation du désir.
Ce qu’il faut retenir :
un couple renaît quand la forme change, pas quand on demande à l’autre de faire plus.
14. Et si la séparation devient réelle ?
Protégez l’enfant. Évitez la violence verbale. Restez une équipe parentale. Clôturez avec respect.
Parce que même quand l’histoire d’amour finit, la famille, elle, doit rester stable, respirante et sécurisante.
15. Quand consulter un thérapeute de couple ?
Maintenant. Car la phrase "je veux vivre ma vie" est un moment pivot : c’est là que la réorganisation est possible.
En consultation, on travaille :
-
la saturation,
-
le corps,
-
la place,
-
l’attachement,
-
la famille,
-
et la vérité du lien.
Autrement dit : c’est là que les couples changent vraiment.

CONCLUSION
Pour nous résumer, ce n’est pas l’amour qui flanche : c’est la forme du couple qui n’arrive plus à contenir deux trajectoires qui évoluent. Autrement dit, la crise de couple n’est pas une rupture du lien, mais la rupture d’un modèle devenu trop étroit pour deux corps, deux histoires et deux vérités intérieures.
Ainsi, ce tournant ne dit pas "je pars", mais "je ne peux plus continuer ainsi".
Ce qui permet de traverser : revenir au corps, dire vrai et réorganiser le lien
Pour traverser ce tournant sans casser la famille, il est vital d’abord de revenir au corps : respiration, fatigue, pulsation, désir.
Puis, il est nécessaire d'ouvrir la vérité relationnelle, sans accuser, sans cacher, sans fuir.
Enfin, il est opportun de réinventer la structure du couple : place, rôle, charge affective, communication, alliance parentale. C'est tout l'enjeu d'un travail en thérapie de couple.
En d’autres termes : ce n’est pas en demandant plus d’efforts que l’on sauve un couple, mais en réorganisant le lien pour qu’il respire à nouveau...
Ce qui renaît : un couple plus juste… ou un soi plus vrai
Pour conclure, chaque crise de couple ouvre une bifurcation :
-
soit le couple se réajuste et retrouve sa vitalité,
-
soit l’un retrouve son axe et son intégrité en solo.
Et les deux issues sont des renaissances. Parce qu’on ne quitte jamais vraiment l’autre : on quitte la version de soi que l’on ne peut plus habiter. Et cette vérité, lorsqu’elle est dite avec courage et tendresse, devient un modèle de lien conscient pour la famille entière.
Bibliographie
Audibert, C. (2018). Les blessures d’attachement. Paris : Payot.
Auerbach, J.G. (2000). « Le désir et ses entraves ». Revue française de psychanalyse, 64(2), 491-508. (Cairn.info)
Bacqué, M.-F. (2017). Le deuil, la perte et le chagrin. Paris : Odile Jacob.
Bateson, G. (1977). Vers une écologie de l’esprit. Paris : Seuil.
Beauchamp-Tremblay, N. (2018). « Le fardeau invisible du care : charge mentale et charge émotionnelle dans les familles ». Nouvelles pratiques sociales, 31(1), 145-162. (Érudit / indexé via Cairn)
Bogaerts, S. & Guéritaud, C. (2019). « Attachement et dynamique conjugale ». Dialogue. Familles & Couples, 213(3), 41-54. (Cairn.info)
Bowlby, J. (1982). Attachment and Loss. Vol.1 : Attachment. New York : Basic Books.
Brenot, P. (2014). Inventer le couple. Paris : Les Liens qui Libèrent.
Brenot, P. (2017). Les hommes, le sexe et l’amour. Paris : L’Iconoclaste.
Crépault, C. (2015). La sexualité masculine : mythes, réalités et enjeux. Québec : Presses de l’Université Laval.
Crépault, C. (2020). « Attachement et sexualité : entre continuité et rupture ». Revue québécoise de sexologie, 15(1), 37-48.
Cyrulnik, B. (2001). Un merveilleux malheur. Paris : Odile Jacob.
Cyrulnik, B. (2019). La nuit, j’écrirai des soleils. Paris : Odile Jacob.
Cyrulnik, B. (2012). « La résilience et les systèmes humains ». Journal des psychologues, 299(3), 38-43. (Cairn.info)
Declef, A. (2016). « Le couple contemporain face aux injonctions d’épanouissement ». SociologieS, HS, 1-15. (Cairn.info)
Guédeney, N. & Guédeney, A. (2010). L’attachement : approche théorique. Paris : Masson.
Guédeney, A. (2013). « Comprendre la sécurité affective de l’enfant ». Enfances & Psy, 59(4), 32-45. (Cairn.info)
Guichard-Claudic, Y. (2020). « Dire la vérité aux enfants : enjeux et limites dans les familles en transition ». Dialogue. Familles & Couples, 227(1), 75-88. (Cairn.info)
Illouz, E. (2012). Pourquoi l’amour fait mal. Paris : Seuil.
Illouz, E. (2019). Les émotions capitalistes. Paris : Seuil.
Illouz, E. (2013). « L’individu amoureux dans la modernité tardive ». Revue du MAUSS, 42(2), 151-172. (Cairn.info)
Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Cambridge, MA : Harvard University Press.
Minuchin, S. & Fishman, H.C. (1981). Family Therapy Techniques. Cambridge, MA : Harvard University Press.
Molinier, P. (2009). « Fatigue du care, charge mentale et invisibilité ». Travail, genre et sociétés, 22(2), 27-45. (Cairn.info)
Molinier, P. (2013). Le travail du care. Paris : La Dispute.
Pierrehumbert, B. (2003). « Attachement, régulations émotionnelles et psychisme ». Développements, 1(1), 13-23. (Cairn.info)
Pudlowski, D. (2018). « L’enfant pris dans le conflit de loyauté ». Dialogue. Familles & Couples, 220(4), 89-101. (Cairn.info)
Scelles, R. (2003). « L’enfant symptôme dans la famille : lecture systémique ». Thérapie familiale, 24(2), 179-195. (Cairn.info)
Schmid Mast, M. (2016). « Stress, charge mentale et relations interpersonnelles ». Psychologie Française, 61(3), 245-258. (Cairn.info)
Tisseron, S. (2011). Les secrets de famille. Paris : Marabout.
Tisseron, S. (2015). « Le corps qui parle : langage non-verbal et attachement ». Enfances & Psy, 68(2), 19-30. (Cairn.info)

NeoSoi - Dr Céline BERCION - psychologue sociale et systémique, thérapie de couple et sexothérapie - Bordeaux et visio
36 Avenue Roger Cohé
33600
Pessac
France
Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités

