C’est quoi un homme déconstruit ? Comment se réinventer sans se perdre dans le couple moderne
Depuis quelques années, un nouveau phénomène s’impose dans les couples : l’émergence d’hommes qui se définissent comme "déconstruits". Le terme circule massivement (sur les réseaux sociaux, dans le débat féministe, dans les discours masculinistes, dans les podcasts sur les relations) et jusque dans les cabinets de thérapie de couple / sexothérapie. Mais derrière le mot, il y a une réalité bien plus complexe que ce que l’on en dit.
Dans les séances, les femmes me confient :
"Je suis épuisée. Je porte tout. Je n’ai plus de désir".
Et les hommes me disent :
"Je veux être respectueux, attentif, équitable… mais je ne sais plus quoi faire dans mon couple sans être critiqué".
Ce décalage n’est pas anecdotique : en fait, il structure aujourd’hui la majorité des crises conjugales. Il s’inscrit dans un contexte social chargé : charge mentale écrasante pour les femmes, montée des discours masculinistes, exigence de sécurité émotionnelle, évolution des normes sexuelles et du consentement, exposition massive au porno, redistribution inégale des tâches domestiques et transformation profonde du rôle paternel et partenaire.
Sur le plan clinique, cette transition crée une situation inédite :
-
des hommes qui veulent bien faire mais n’osent plus faire (ou lâche l'affaire...),
-
des femmes qui portent tellement qu’elles n’ont plus d’espace psychique pour désirer,
-
une sexualité fragilisée non par manque d’amour mais par surcharge,
-
une désorientation masculine qui ressemble à de l’effacement,
-
une fatigue féminine qui ressemble à du désintérêt,
-
et un couple qui se dérègle par désynchronisation des rythmes internes.
Les recherches sociologiques et psychologiques convergent :
➡️ la déconstruction masculine n’est pas un aboutissement, mais une étape transitoire entre des modèles anciens devenus obsolètes et des modèles nouveaux qui ne sont pas encore stabilisés.
➡️ la charge mentale féminine n’est pas une émotion, mais un fait social total, qui impacte directement le désir, la disponibilité et la sécurité affective.
➡️ le couple moderne ne souffre pas d’un déficit d’amour, mais d’un déficit de repères, de lisibilité, de réciprocité et d’ajustements internes.
Dans ce moment historique où les masculinités se redéfinissent et où les femmes réclament un partage réel du quotidien, une question centrale émerge : comment se réinventer sans se perdre ? Comment retrouver de la clarté, du désir, de la sécurité émotionnelle et un lien juste, sans revenir aux modèles du passé ni tomber dans une neutralisation du masculin qui épuise tout le monde ?
Cet article propose une lecture solide, scientifique et accessible de ce mouvement :
-
ce qu’est réellement un homme déconstruit,
-
pourquoi sa transition crée autant de tensions dans le couple,
-
comment la fatigue féminine et la prudence masculine s’alimentent mutuellement,
- pourquoi la sexualité se dérègle dans ces contextes,
- comment habiter une masculinité sensible, incarnée, désirable et responsable, sans basculer ni dans la soumission ni dans la réaction ?
-
et comment reconstruire un couple équilibré, désirant et lisible.
C’est un article pour les hommes en perte de repères, pour les femmes à bout de souffle et pour les couples qui sentent que quelque chose glisse… sans comprendre encore quoi.

1 - D’où vient vraiment l'expression "l’homme déconstruit" ?
Mutation sociale, psychique et symbolique du masculin
L’homme déconstruit n’est pas un individu isolé qui aurait un problème personnel. C’est, au contraire et avant tout, le résultat d’une mutation collective et extrêmement profonde. Pour comprendre ce qui se joue dans les couples, dans le désir et dans la sexualité, il faut d’abord regarder ce qui se transforme dans la société, dans l’histoire et dans les héritages familiaux. C’est en replaçant l’homme dans ce réseau de forces que son "remaniement identitaire" devient intelligible et que la déstabilisation du couple prend aussi son sens.
1.1. L’effondrement du modèle masculin traditionnel (Connell, Illouz)
Malgré sa diffusion massive, l’expression reste floue, ambiguë et souvent utilisée comme une étiquette (valorisante ou méprisante) plutôt qu’un concept réel.
Cliniquement, socialement et sexuellement, ce terme désigne non pas un modèle achevé, mais une transition : un homme qui ne veut plus reproduire les scripts masculins traditionnels, mais qui ne sait pas encore comment habiter des repères nouveaux.
Il est entre deux mondes. Et c’est précisément cette zone de transition qui crée des tensions dans le couple.
Depuis plusieurs décennies, le modèle de virilité dominante décrit par R.W. Connell s’est fissuré. Alors certes, l’image de l’homme fort, sûr de lui, peu expressif et protecteur, a longtemps fait office de repère omnipotent. Néanmoins, aujourd'hui ce modèle ne correspond plus exactement ni aux attentes contemporaines ni aux valeurs du couple moderne. Comme l’explique Eva Illouz, la sphère amoureuse et sexuelle est désormais traversée par des injonctions de transparence émotionnelle, d’égalité, de communication et de sensibilité.
Au-delà de ces transformations idéologiques, les hommes ont dû internaliser des normes nouvelles sans qu’aucune transmission intergénérationnelle ne vienne les accompagner.
Par ailleurs, là où l’ancien masculin s’apprenait par imitation (père, pairs, groupe d’hommes), le masculin moderne n’a pas de guide clair.
En réalité, l’effondrement du modèle viril traditionnel n’a pas été compensé par un nouveau modèle. Il existe donc un vide identitaire masculin, qui laisse les hommes dans une zone d’incertitude permanente.
Précision essentielle : de quel homme parle-t-on exactement ?
Contrairement à ce que prétendent certains discours, il n’existe pas un "homme déconstruit" universel. Les sociologues montrent que ce phénomène concerne principalement :
-
les hommes urbains,
-
diplômés,
-
issus de milieux professionnels où l’égalité est valorisée,
-
socialisés dans des environnements sensibles au consentement, au féminisme et aux enjeux relationnels contemporains,
-
exposés aux débats sur la charge mentale, la parentalité moderne, l’éducation égalitaire et les questions de genre.
Ces hommes sont davantage confrontés à la remise en question de leurs repères identitaires, parce qu’ils baignent dans des discours et des attentes contradictoires : être sensible mais pas fragile, être non toxique mais rester désirant, être respectueux sans être passif, être engagé sans être envahissant.
À l’inverse, dans les milieux plus ruraux, ouvriers ou traditionnels, la masculinité continue d’être structurée par :
-
la force de travail,
-
le rôle de pourvoyeur,
-
les modèles paternels antérieurs,
-
une répartition genrée plus classique,
-
des référentiels moins centrés sur la vulnérabilité émotionnelle,
-
un rapport différent au féminisme et aux normes du consentement.
La transition existe aussi dans ces milieux, mais elle ne prend pas la même forme.
Le terme "homme déconstruit" désigne donc une catégorie sociale située, pas un archétype global. Cette nuance est indispensable pour analyser ce qui se passe réellement dans les couples.
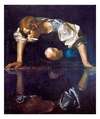
1.2. L’explosion des scripts de genre (Goffman, Butler)
Du point de vue de la psychologie sociale, des chercheurs comme Erving Goffman ou encore Judith Butler ont montré que la masculinité n’est pas innée : elle se joue, se répète, se performe. Or, ce sont précisément ces "scripts" masculins qui sont aujourd’hui bouleversés (ou challengés, tout dépend de l'angle de vue). Si autrefois la place de l’homme était socialement définie, aujourd'hui, elle est négociée, révisée, discutée, contestée.
L’homme dit "déconstruit" n’accepte plus, ou ne veut plus accepter, les codes masculins classiques :
-
domination dans le couple,
-
prise de décision unilatérale,
-
minimisation des émotions,
-
sexualité centrée sur la performance,
-
absence d’implication domestique,
-
virilité comme marqueur principal d’identité.
Il interroge ce qu’il a reçu, ce qu’il a incarné, ce qu’il ne veut plus reproduire. C’est une étape nécessaire, saine, adulte. Cependant, en renonçant à ces repères, il perd aussi les scripts qui organisaient ses comportements. Ce renoncement est un terrain fertile pour la confusion.
Au-delà de cette perte de repères, l’homme est désormais confronté à une exigence contradictoire : être viril mais pas dominateur, être sensible mais pas fragile, être désirant mais jamais oppressant, être présent mais surtout pas intrusif.
Par ailleurs, cette contradiction crée ce que la systémie appelle une double contrainte : quelle que soit la direction qu’il prend, l’homme contemporain risque d’être "en faute" permanente. Et cette tension intérieure nourrit chez lui une forme d’hyper-correction qui, certes, cherche à éviter les erreurs du passé, mais finit par étouffer les élans spontanés, notamment dans la sexualité et la prise d’initiative relationnelle.
Ainsi, je dirais que l’homme déconstruit" n’est pas un homme "moderne".
Il est avant tout un homme pris entre deux scripts incompatibles.
1.3. Un homme sous vigilance morale : culpabilité, autocensure et peur d’imposer
Avec l’explosion des violences révélées par #MeToo et la prise de conscience massive des dynamiques d’emprise, beaucoup d’hommes ont intégré une vigilance accrue, voire permanente. Ils ne veulent plus blesser, ne plus imposer, ne plus dépasser une limite. Et au-delà de cette intention sincère, cette autocensure interne peut devenir paralysante.
Par ailleurs, dans ma pratique, je rencontre très souvent des hommes qui me disent : "je ne veux pas / plus être comme mon père", ou encore : "j’ai peur d’être perçu comme lourd, oppressant, trop sexuel". C'est cette peur qui les conduit à lisser leur présence, à diminuer leur intensité, voire à neutraliser leur désir.
En réalité, je constate que beaucoup d’hommes qui viennent en consultation vivent aujourd’hui dans une forme de surveillance morale intérieure qui les coupe de leur puissance, de leur spontanéité et de leur énergie sexuelle.

1.4. La montée des masculinistes : la réaction crispée au vide identitaire
Petit apparté ...
À l’opposé de l’homme trop correct ou trop adaptable, un autre mouvement émerge : celui des masculinistes. Comme l’a montré Daniel Welzer-Lang, ces groupes attirent principalement des hommes blessés, humiliés, qui se sentent marginalisés par les nouvelles normes sociales. Certes, ils expriment une souffrance réelle ; mais ils y répondent par un retour à la domination, à la rigidité et à la réaffirmation d’une virilité autoritaire.
Au-delà de ce positionnement politique, le masculiniste représente en réalité une réaction défensive à la déconstruction.
Là où l’homme déconstruit se culpabilise, le masculiniste se crispe.
Là où le premier s’efface, le second se durcit.
Par ailleurs, tous deux témoignent d’un même phénomène : le masculin n’a plus de repères stables. Et parfois les conséquences sont dramatiques (pour rappel : 1 femme meurent tous les 3 jours, en France, sous les coups de son mari ou ex-mari).
Il est essentiel de préciser cela pour ne pas tomber dans la caricature. Le masculiniste n’est pas un "monstre misogyne" qui peut aller jusqu'à commettre un crime. C’est souvent un homme qui n’a trouvé aucun espace intérieur ou symbolique pour penser sa souffrance... et qui, pour nombre d'entre eux, ne va malheureusement pas aller chercher un espace thérapeutique pour travailler cela ...
1.5. L’héritage transgénérationnel : un masculin sans transmission (Corneau)
Au-delà des enjeux sociaux, la crise du masculin se joue aussi dans la filiation. Guy Corneau l’a parfaitement décrit dans ses ouvrages : beaucoup d’hommes contemporains ont grandi avec un père absent, rigide, inaccessible ou blessé. Par ailleurs, certains ont vécu avec un père émotionnellement "inerte" qui ne parlait ni de sa sensibilité ni de sa fragilité.
Néanmoins, ces mêmes hommes souhaitent aujourd’hui devenir des partenaires sensibles et conscients.
Ce paradoxe crée ainsi une tension psychique : ils veulent s’éloigner du modèle paternel tout en n’ayant jamais reçu d’alternative incarnée. De surcroît, la peur de reproduire les blessures du père les pousse parfois à surdoser la douceur, au détriment de leur désir, de leur affirmation et de leur ancrage.
Ainsi, et pour faire simple, on pourrait dire les choses ainsi : l’homme déconstruit porte souvent une lignée masculine coupée, sans initiation, sans transmission, sans mentorat du masculin.

1.6. Archétypes masculins fragmentés : Roi, Guerrier, Amant et Sage (Bly, Moore & Gillette)
Au-delà des dimensions sociologiques et familiales, il existe également une dimension symbolique essentielle. A ce sujet, Robert Bly et Moore & Gillette ont montré que la psyché masculine repose sur 4 grands archétypes fondamentaux : le Roi (ordre intérieur), le Guerrier (puissance), l’Amant (désir) et le Sage (verticalité). Et dans notre époque, ces figures ont du mal à émerger. Soit elle ont été écrasées par les excès du patriarcat, soit elle ont été délégitimées par la culture contemporaine.
Par ailleurs, beaucoup d’hommes redoutent désormais d’incarner la puissance du Guerrier, confondue avec violence ; l’autorité du Roi, confondue avec domination ; le désir de l’Amant, confondu avec danger ; ou la profondeur du Sage, confondue avec passivité. Certes, la déconstruction était nécessaire ; néanmoins, elle a parfois gelé ces forces intérieures au lieu de les rééquilibrer.
Ainsi, l’homme déconstruit n’est pas un homme "évolué".
C’est souvent un homme désorganisé symboliquement, qui a désactivé ses archétypes plutôt que de les intégrer.
Comme nous venons de le voir, au-delà de la critique sociale, au-delà de la déconstruction nécessaire et au-delà des réactions crispées, la notion "d’homme déconstruit" parle avant tout d'une crise identitaire systémique. Pris entre la peur de faire mal et la peur de disparaître, il existe dans une zone instable où ni l’ancien masculin ni le nouveau ne sont pleinement habitables.
C’est cette crise, profonde et silencieuse, qui, aujourd'hui bouleverse les couples, le désir et la sexualité. C'est un constat quotidien que nous, thérapeutes de couples et sexothérapeutes, faisons.
Et c’est précisément à cette endroit-là que peut s’ouvrir une nouvelle question : qu’est-ce qu’un homme déconstruit sur le plan psychologique, sexuel et relationnel ? Et pourquoi cette déconstruction provoque-t-elle autant de confusion dans le couple moderne ?

2 - Les piliers de la déconstruction masculine
Une masculinité en transition, entre auto-inhibition, confusion identitaire et perte d’axe
Dans les couples hétérosexuels contemporains, l'image de "l’homme déconstruit" est devenue aujourd'hui courante : un homme sensible, attentif, respectueux, désireux de ne pas reproduire les violences ordinaires du masculin ancestral.
Pour autant, dans mon cabinet, une autre réalité apparaît : une masculinité souvent rétractée, parfois véritablement prudente, voire trop vigilante, parfois coupée de son désir et de son axe.
Dans cette partie, je vous propose d'explorer comment la déconstruction, lorsqu’elle n’est pas suivie d’une véritable incarnation, transforme l'homme dans son rapport à lui-même, à son corps, son désir et à son couple.
Ce processus à l'oeuvre n’est pas une critique : c’est une lecture clinique, sociale, systémique, symbolique, et, surtout, profondément humaine.
2.1. Dans la psyché : une conscience hypertrophiée qui devient un frein invisible
L’homme déconstruit a grandi dans un climat moral où son désir, sa force ou son initiative ont été systématiquement passés au tamis. Il a entendu, implicitement ou explicitement : "Fais attention. Retiens-toi. Ne prends pas trop de place".
Certes, cette vigilance peut devenir un atout éthique. Néanmoins, lorsqu’elle devient une norme intérieure, elle produit une forme d’auto-surveillance permanente.
Cet homme déconstruit vit dans un monologue silencieux : "est-ce que je parle trop ? Est-ce que je suis trop présent ? Trop intense ? Trop insistant ? Pas assez sensible ? Trop direct ?". Ah le fameux "trop" / "pas assez" ...
Ce phénomène est bien connu en psychologie sociale : c’est la norme d’internalité (Cf. Beauvois & Dubois) qui, poussée à son extrême, va véhiculer l’idée que l’homme doit en permanence se responsabiliser pour tout, même pour ce qu’il ne maîtrise pas.
Par ailleurs, beaucoup de ces hommes décrivent un père absent, un père effacé, un père instable ou un père dont la présence n’a jamais vraiment été incarnée. Ils n’ont ainsi pas désappris leur masculin : ils n’ont surtout jamais reçu d’incarnation masculine stable à intérioriser.
Et ce vide, la société moderne l’a rempli… par la prudence.
2.2. Dans le corps : un masculin rétracté, une intensité contenue
Lorsque l’on observe ces hommes en séance, avant même de parler, on voit un signe clair : leur énergie ne descend pas. Le souffle reste haut. La poitrine se bloque légèrement. Le bassin n’avance plus. Le regard guette la réaction de l’autre.
En d'autres termes, le système nerveux autonome parle avant leur bouche. Et la théorie polyvagale le montre bien : lorsque l’homme a peur d’être perçu comme "trop", son système passe en inhibition active.
Il ne fuit pas. Il ne agresse pas. Il se retient.
Cette inhibition chronique crée un phénomène que j’appelle souvent, en séance, le masculin suspendu : un masculin vivant mais non habité, présent mais en altitude, désirant mais débranché de la base du corps. Dans la clinique sexuelle contemporaine, cette tension est fortement corrélée à l’augmentation des troubles du désir masculin et à certains troubles érectiles psychogènes (Études de Marie-Laure Del Vecchio, Pr Patrice Lopès, Philippe Brenot).
Ici, la corrélation est claire :
➡️ Quand l’homme se surveille, son corps se referme. Quand son corps se referme, son désir perd son impulsion.

2.3. La déconstruction masculine n’est plus un progrès,
mais un moteur d’épuisement relationnel.
Il faut maintenant regarder la scène conjugale, le théâtre où tout se joue. Pour comprendre ce qui se joue aujourd’hui dans les couples, il faut cesser d’opposer hommes et femmes. Ce n’est pas un duel : c’est une mise en tension de deux fatigues différentes, qui se chevauchent et se répondent sans que personne ne les nomme.
Ces fatigues ne sont pas symétriques ; néanmoins, elles interagissent puissamment. Et si elles ne viennent pas des mêmes sources, elles produisent néanmoins les mêmes effets :
➡️ une perte de vitalité dans le lien.
C’est précisément ça qui érode la polarité, le désir et l’élan amoureux.
Dans les couples modernes, deux fatigues se croisent :
✔ La fatigue féminine : structurelle, objectivable, étayée
Les femmes ne sont pas seulement émotionnellement fatiguées : elles sont structurellement sursollicitées.
Les études françaises et internationales convergent :
-
la charge mentale (Haicault, 1984 ; Daminger, 2019) reste massivement féminine ;
-
le care émotionnel (Pascale Molinier, Le travail du care, 2013) repose majoritairement sur les femmes ;
-
la gestion domestique invisible (Mona Chollet, Réinventer l’amour, 2021) demeure déséquilibrée ;
-
l’anticipation permanente (ce que Nicole Guédeney appelle l’hypervigilance affective) est largement féminine ;
-
la charge contraceptive, morale et mentale, est presque exclusivement féminine (Brenot, 2017).
Comme le rappelle Eva Illouz (Cairn.info, 2020) : l’épuisement féminin n’est pas psychologique ; il est produit par l’organisation sociale du couple moderne.
Cette fatigue n’est pas une impression. C’est une donnée mesurable.
Par ailleurs, cette fatigue a un effet direct, documenté, sur :
-
la baisse du désir féminin,
-
l’effritement de la disponibilité émotionnelle,
-
la perte de réceptivité dans l’échange amoureux et sexuel.
On ne peut donc pas analyser le couple sans tenir compte de ce socle.

✔ La fatigue masculine : psychique, internalisée, elle aussi étayée par la recherche
À l’inverse, les hommes ne vivent pas une fatigue structurelle comparable.
Cependant (et c’est ici que les travaux récents sont éclairants) ils portent une fatigue morale et identitaire d’une intensité inédite.
Les hommes déconstruits prennent conscience de réalités longtemps invisibilisées :
-
la charge mentale,
-
le travail domestique non reconnu,
-
le care émotionnel féminin,
-
les violences sexistes et sexuelles,
-
la pression cognitive sur les femmes,
-
les inégalités persistantes dans la parentalité,
-
la surcharge des femmes dans les tâches invisibles.
Pour beaucoup d’hommes, cette prise de conscience génère une forme de culpabilité identitaire, voire une prudence extrême dans leurs gestes, leurs paroles ou leur désir. Ils veulent bien faire ; parfois trop.
Les recherches de Christophe Giraud (Sociologie de la sexualité, PUF, 2019), de David Le Breton (ECL - anthropologie des émotions, 2017) et plus récemment de Baptiste Morizot (L’invention du masculin, 2023) montrent que beaucoup d’hommes contemporains :
-
doutent de leur légitimité dans le couple,
-
se méfient d’eux-mêmes,
-
s’auto-surveillent en permanence,
-
neutralisent leur désir de peur d’être perçus comme déplacés,
-
internalisent les normes de prudence, d’hyper-correction et d’ajustement extrême.
En sexologie, cette fatigue psychique se traduit par :
-
un taux croissant de troubles érectiles psychogènes chez les hommes jeunes (Mimoun, Les troubles de l’érection, 2021),
-
une augmentation notable de l’anxiété de performance (Crépault, Université Laval),
-
un décrochage entre désir et initiative, devenu un phénomène émergent (Del Vecchio & Poudat, 2018).
Autrement dit :
➡️ la fatigue masculine n’est pas domestique, mais psychique et somatique. Elle se loge dans le souffle, la posture, la vigilance excessive, la peur de trop en faire, la peur d’être mal perçu, la peur d’être "trop".
Alors certes, cette fatigue ne porte pas le foyer. Néanmoins, elle porte un surmoi moderne terriblement lourd à porter.

✔ La boucle circulaire : quand deux fatigues s’enclenchent l’une l’autre
Lorsque l’on observe les couples avec un regard systémique (Palo Alto, Milan, Rome), on voit rapidement que ces deux fatigues (structurelle pour elle, psychique pour lui) s’emboîtent comme deux pièces d’un même mécanisme. Parce que dans le couple, tout se joue en interaction.
Et quand :
-
l’un perd ses repères,
-
l’autre compense,
-
l’un hésite,
-
l’autre sature,
-
l’un se retient,
-
l’autre porte tout,
-
l’un doute de son désir,
-
l’autre n’a plus de disponibilité,
Ce n’est pas une dynamique consciente. Ce n’est pas un conflit.
➡️ C’est une spirale interactionnelle autopoïétique, typique du modèle systémique. Chacun réagit au comportement de l’autre… et alimente, sans le vouloir, ce qu’il cherche à éviter.
En outre, plus la boucle se répète, plus elle devient silencieuse et plus le couple croit que "c’est l’amour qui s’est usé".
Alors qu’en réalité,
➡️ c’est la dynamique qui s’est figée.
Pour de nombreux couples, la déconstruction masculine n’est plus un progrès, mais un moteur d’épuisement relationnel.
Autrement dit :
Tant que l'on décrit l’homme comme "manquant" et la femme comme "épuisée", on passe à côté du vrai problème : la rencontre entre une fatigue structurelle féminine et une fatigue psychique masculine.
Ce n’est pas un déséquilibre. C’est une rétro-boucle. Une boucle qui n’a pas d’auteur unique. Une boucle qui se crée à deux et qui peut également se défaire à deux.
Ce n’est pas l’homme déconstruit qui fatigue le couple, mais l’absence de modèle alternatif pour remplacer les anciens repères.

2.4. Le désajustement identitaire qui suit la prise de conscience
C’est le point le plus sensible : l’homme déconstruit sait ce qu’il ne veut plus être, mais il ne sait pas encore ce qu’il peut être.
La transition crée alors :
-
une hésitation constante,
-
une vigilance excessive,
-
une neutralisation de l’initiative,
-
une difficulté à exprimer le désir,
-
une baisse de spontanéité,
-
un effacement partiel de sa présence,
-
une peur de déplaire ou de dépasser les limites,
-
une tension interne qui fatigue le couple.
Ce n’est pas un manque d’amour ni un désintérêt.
C’est une désorientation identitaire.
Et cette zone de désorientation est le terreau de nombreuses incompréhensions : elle peut être lue comme un manque d’engagement ou comme de la mollesse ou comme un retrait, alors qu’en fait il s’agit d’un processus de transformation non accompagné.

2.5. Dans la sexualité : un désir présent, mais une initiative coupée
Contrairement aux idées reçues, "l’homme déconstruit" désire. Il est excité, sensible, imaginatif, vibrant. Parfois, même davantage que les hommes "classiques".
Mais il n’a plus de porte d’entrée vers l’initiative.
Il attend un signal clair et sûr. Il attend d’être invité. Il attend de ne "jamais" se tromper.
Et pendant qu’il attend, le désir se dissout.
La sexologie francophone (portée notamment par Brenot, Crépault, Del Vecchio ou encore Mimoun) décrit très bien ce phénomène émergent :
➡️ un désir préservé mais une action inhibée.
➡️ une envie intacte mais un passage au geste bloqué.
Certes, il est doux. Certes, il est respectueux.
Néanmoins, quand le geste n’existe plus, la sexualité devient un terrain sans tension, sans polarité, sans intensité.
Ce qui m'amène à avancer l'idée selon laquelle la femme ne manque pas de désir :
➡️ elle manque d’une présence qui dialogue avec le sien. Nuance.
2.6. La honte masculine contemporaine : l’angle mort le plus tabou
Oui, beaucoup d’hommes ont honte de leur désir. Honte d’être traversés par quelque chose de trop vivant. Honte d’approcher. Honte de vouloir.
Et cette honte est psychogène, héritée, médiatique, culturelle, transgénérationnelle.
Elle ne vient pas de la femme ; elle vient avant tout du climat social. La nuance est de taillle !!
Néanmoins, elle ne suffit pas à expliquer la baisse de polarité dans le couple.
Elle rencontre la fatigue féminine.
Elle rencontre la charge relationnelle.
Elle rencontre la solitude domestique.
Pour le dire autrement, je dirais que ce n’est pas la honte masculine contre la fatigue féminine qui se joue.
➡️ Ce qui se joue, c’est l’articulation systémique de deux vulnérabilités différentes.

3. Pourquoi la mue masculine crée une zone de turbulence dans le couple (et ce qu’elle révèle réellement)
Ce qui crée de la souffrance dans les couples d’aujourd’hui n’est pas l’homme déconstruit en lui-même.
Ce n’est pas non plus la fatigue féminine.
Ce n’est même pas l’érosion du désir, ni la baisse de polarité.
Ce qui fait souffrir profondément le couple, c’est la zone de turbulence créée par la mue masculine.
Cette période transitoire, troublante, où les rôles internes se réorganisent sans que personne ne sache encore ce qui se passe.
Cette zone n’est ni un accident, ni une panne, ni un aveu d’échec. C’est une réorganisation du système, douloureuse pour les deux, mais structurante si elle est traversée consciemment.
3.1. Parce que la mue masculine crée une perte temporaire d’orientation interne
Lorsqu’un homme sort du modèle hérité (directif, silencieux, autosuffisant) il perd d’abord les anciens repères… avant de bâtir les nouveaux. C'est évident d'un point de vue intellectuel ; ça l'est beaucoup moins dans la pratique.
Cette liminalité produit un phénomène que l’on retrouve en systémique (Palo Alto) :
➡️ le temps de latence identitaire.
Ce n’est pas de l’effacement, ni de la fuite, ni de la lâcheté. C’est un intervalle, plus ou moins long, entre deux versions de lui-même.
Certes, pour la femme, ce flou peut ressembler à un retrait difficile à vivre. Néanmoins, pour l’homme, c’est souvent un moment où tout s’ouvre en même temps :
-
qui suis-je dans ce couple moderne ?
-
comment exprimer mon désir sans craindre la maladresse ?
-
comment être présent sans être intrusif ?
-
comment soutenir sans être contrôlant ?
-
comment incarner un masculin différent ?
Ce questionnement n’est pas un déficit. C’est processus, une réinitialisation intérieure.

3.2. Parce que cette désorientation masculine bouscule immédiatement la dynamique d’attachement
Dans la clinique du couple, ce que l’on observe n’est pas une baisse d’amour :
➡️ c’est une désorganisation du système d’attachement.
Quand l’homme perd temporairement son axe interne, la femme ressent (non pas un manque d’intérêt) mais une incohérence énergétique.
-
Il est là physiquement,
-
mais pas toujours lisible émotionnellement.
Ce décalage active chez elle une hyper-vigilance relationnelle, décrite par Bacqué et Guédeney : comme un état où chaque micro-signe prend une valeur affective disproportionnée.
Par ailleurs, l’homme en mue perçoit très bien cette hyper-vigilance chez la femme. Il la ressent de plein fouet dans la manière dont elle scrute, interroge, attend. Et cela renforce encore plus son hésitation. Aïe ! La spirale infernale s'enclenche et on comprend rien de ce qu'elle nous raconte.
➡️ C’est ici que naît l’angoisse silencieuse du couple contemporain : "je fais tout ce qui est humainement possible de faire, mais y'a rien qui va ; je ne sais plus comment être avec toi".

3.3. Parce que la mue masculine modifie profondément l’énergie sexuelle du couple
Contrairement aux discours simplistes sur la "baisse du désir masculin", ce n’est pas l’envie qui disparaît.
➡️ C’est la direction du désir qui se trouble.
La pulsion reste intacte. Mais le passage du désir au geste se brouille. Non pas par manque d’attirance,
mais par manque d’orientation interne. Cela crée une sexualité qui devient :
-
moins incarnée,
-
moins spontanée,
-
moins polarisée,
-
plus cérébrale,
-
plus hésitante.
La femme ne ressent plus un "désintérêt",
➡️ elle ressent une absence d’intention.
La polarité ne s’éteint pas parce que les partenaires ne s’aiment plus, mais parce que leurs énergies ne se reconnaissent plus.
Cette dynamique est au cœur des recherches en sexo récentes : Crépault, Mimoun, Brenot et Del Vecchio décrivent tous une hausse des désirs présents mais non exprimés, ce qu’ils nomment anxiété d’initiative ou désir inhibé.
C’est cela, la mue masculine :
un désir en attente de nouvelle forme.
3.4. Parce que cette mue vient révéler une confusion ancienne : qui porte quoi dans le couple ?
La modernité a bouleversé les rôles relationnels. Mais les corps, eux, n’ont pas encore intégré ces nouveaux scripts. Ainsi, lorsque l’homme perd son orientation interne et que la femme est saturée par la charge mentale,
une ambiguïté apparaît :
-
Qui initie ?
-
Qui accueille ?
-
Qui donne l’élan ?
-
Qui prend l’élan ?
-
Qui ancre ?
-
Qui relie ?
-
Qui porte ?
-
Qui respire ?
Cette confusion n’est pas récente ; elle était simplement couverte par les anciens modèles.
La mue masculine la met en lumière.
Ainsi donc, de nombreux couples pensent qu’ils manquent d’amour alors que ce dont ils manquent vraiment, c’est un accord clair sur les rôles internes dans la relation.
Pas des rôles genrés. NON. Des rôles énergétiques.

3.5. Parce que la mue masculine fait émerger une peur profonde : "et si on n’était plus compatibles ?"
La baisse d’initiative masculine + la surcharge féminine crée alors un cocktail émotionnel explosif : la peur de la désaffection.
-
Elle se dit : "je ne lui fais plus envie"
-
Il se dit : "je ne suis plus à la hauteur"
-
Elle se dit : "je suis seule dans le lien"
-
Il se dit : "je ne suis plus utile"
-
Elle se dit : "quelque chose s’est cassé"
-
Il se dit : "je suis en train de la décevoir"
En fait, cette peur est un faux diagnostic. Mais elle produit un vrai dommage.
Ce n’est pas une baisse d’amour. C’est une dissonance énergétique.
Le couple souffre alors non pas d’un manque, mais d’un mauvais alignement temporaire.
3.6. Parce que si la mue masculine n’est pas accompagnée, elle peut dériver
Quand l’homme ne comprend pas ce qui lui arrive et que la femme n’a plus d’espace pour décoder cette mue,
deux dérives apparaissent alors fréquemment :
Dérive 1 - L’effacement chronique
L’homme devient "trop gentil", "trop prudent", "trop correct". Il perd sa place dans le couple moderne. Il se sur-adapte. Il perd son appétit. Il neutralise tout ce qui pourrait être vivant.
Dérive 2 - La crispation identitaire
Lorsque trop d’hésitation s’accumule, une explosion émotionnelle peut survenir : colère, retrait massif, rupture brutale, acting-out, repli.
L’une est glacée.
L’autre est brûlante.
Les deux traduisent le même phénomène :
un masculin qui cherche une nouvelle forme d’incarnation et n’y parvient pas seul.
3.7. Parce que cette mue révèle ce que le couple doit devenir : un lien conscient
La souffrance qui permet d'ouvrir les portes ne dit jamais que "ça ne marche plus". Au contraire, elle dit : "OK, c'est le signal qu'il est temps d’évoluer"
La mue masculine révèle que le couple doit :
-
clarifier ses rôles énergétiques,
-
alléger la charge mentale féminine,
-
soutenir la réincarnation masculine,
-
réapprendre la danse du désir,
-
retrouver un axe commun,
-
créer une présence plus consciente,
-
renouveler le rituel du lien.
C’est une zone de turbulence, certes.
Néanmoins, c’est aussi la porte d’entrée du couple conscient :
un couple qui ne se contente plus d’aimer, mais qui apprend à se transformer, ensemble.

4. Comment se réinventer sans se perdre dans le couple : 5 axes concrets qui transforment vraiment
Après avoir compris l’origine du malaise contemporain entre déconstruction masculine, surcharge féminine et désynchronisation du désir, il faut répondre à la question essentielle : comment retrouver un lien clair, désirant et équilibré sans revenir aux anciens modèles ni s’effondrer dans une neutralisation du masculin ?
La plupart des couples que j’accompagne n’ont pas besoin de "réapprendre à communiquer". Ils savent parler. Ils savent analyser. Ils savent débattre. Leur problème n’est pas la communication : c’est la désorganisation du système relationnel.
Quand l’homme en transition perd ses repères, quand la femme en surcharge perd son espace interne, quand les rôles deviennent flous, quand la charge mentale envahit tout, le couple ne manque pas d’amour : il manque de structure, de lisibilité et de sécurité.
Pour se réinventer sans se perdre, un couple doit restaurer cinq fondations essentielles (lesquelles ne sont ni des recettes ni des techniques, mais des conditions relationnelles validées en psychologie sociale, en systémie, en sexothérapie, dans les travaux sur l’attachement et la charge mentale).
Voici les cinq axes concrets et réellement efficaces qui transforment un couple aujourd’hui.
4.1. Rétablir la lisibilité du couple : clarifier les rôles, les fonctions et les attentes
Dans un couple contemporain, l’égalité ne suffit pas. Il faut de la lisibilité. Sans lisibilité, le système nerveux s’embrouille, le désir s’éteint et chacun se positionne en fonction de ce qu’il croit devoir compenser. En fait, la majorité des couples se perdent non pas par manque d’amour, mais par manque de lisibilité relationnelle. Dans un système, la fonction prime toujours sur l’intention.
Aujourd’hui :
-
les hommes hésitent,
-
les femmes compensent,
-
et personne ne sait vraiment où est la place de chacun.
Un couple ne fonctionne pas sans rôles internes clairs, qu’ils soient traditionnels, redistribués, égalitaires ou queer. Peu importe le modèle choisi : il doit être lisible, explicite et partagé.
Concrètement, voilà la trame :
-
Qui initie la parole ?
-
Qui pose le cadre ?
-
Qui propose du temps ensemble ?
-
Qui organise le quotidien ?
-
Qui ouvre l’élan sexuel ?
-
Qui porte la charge mentale des enfants ?
-
Qui gère les imprévus ?
En systémie, on sait que l’ambiguïté fait dysfonctionner les dynamiques d’attachement. La clarté rétablit la sécurité. Ce n’est ni patriarcal, ni genré, ni normatif : c’est une règle de stabilité systémique.
Un couple queer ou hétéro fonctionne pareil : pas de lisibilité = confusion = désorganisation = baisse du désir.

4.2. Rééquilibrer la charge mentale : condition indispensable au retour du désir
Tant que la charge mentale féminine reste inchangée, aucune stratégie sexo ne fonctionne. Le cerveau épuisé n’a pas de disponibilité libidinale.
A ce niveau-là, toutes les données convergent : la charge mentale féminine est le premier facteur de baisse de désir dans les couples modernes.
Pas la routine. Pas le manque d’amour. Pas le temps qui passe. NON
➡️ La charge mentale on vous dit.
Si la femme continue à :
-
penser à tout,
-
anticiper tout,
-
organiser tout,
-
réguler tout,
-
gérer les enfants,
-
piloter l’émotionnel,
-
surveiller l’agenda,
-
porter la vigilance du foyer,
alors aucune libido durable n’est possible, même avec un partenaire aimant, respectueux et "déconstruit".
Rééquilibrer signifie :
-
prise d’initiative réelle (pas "tu n’avais qu’à demander"),
-
planification partagée,
-
autonomie domestique,
-
responsabilité emotionnelle co-portée,
-
charge cognitive répartie,
-
arrêt des micro-délégations,
-
implication stable.
Ce n’est pas un geste féministe ; c’est un geste de santé sexuelle.
Quand la femme cesse d’être le "manager" du foyer, son système nerveux se détend ;
et lorsqu’il se détend, alors le désir peut réapparaître.

4.3 Restaurer l’initiative relationnelle sans tomber dans la pression ou la domination
Comme nous l'avons vu, l’un des effets secondaires de la déconstruction masculine est l’inhibition. Beaucoup d’hommes ne savent plus comment initier -
ni dans la relation,
ni dans la sexualité,
ni dans la présence.
Redisons-le : ce n’est pas un manque de désir ; c’est la peur d’être perçu comme intrusif, lourd, inapproprié ou toxique.
Mais un couple sans initiative claire devient :
-
plat,
-
neutre,
-
fonctionnel,
-
désérotisé.
La solution n’est pas de revenir aux anciens modèles, mais d’apprendre une initiative moderne :
-
lisible,
-
consentie,
-
progressive,
-
non performative,
-
non sexualisée immédiatement,
-
respectueuse du rythme de l’autre,
-
fondée sur la présence et non sur l’attente.
En sexothérapie, lorsque l’initiative relationnelle est restaurée (quel que soit le genre), le désir fait surface rapidement car le lien devient de nouveau orienté. CQFD
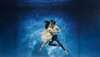
4.4 Redonner de l’espace interne à la femme (ou à la polarité en surcharge)
Dire que "la femme doit retrouver de l’espace interne" n’est pas une injonction genrée : c’est avant tout la description clinique de ce que vivent les personnes en surcharge mentale émotionnelle (souvent des femmes, mais pas exclusivement).
Sans espace interne, le cerveau reste en mode :
-
vigilance,
-
contrôle,
-
gestion,
-
anticipation,
-
charge cognitive,
-
survie relationnelle.
Un cerveau en mode vigilance n’accède ni au désir, ni à la disponibilité, ni à la connexion émotionnelle.
Restaurer l’espace interne implique :
-
réduire la charge mentale,
-
ralentir le flux des demandes,
-
intégrer un vrai soutien,
-
cesser de déléguer émotionnellement à la femme,
-
partager la responsabilité du lien,
-
permettre le repos psychique,
-
soutenir la parentalité (si applicable).
Ce n’est pas "laisser la femme se reposer". Du tout ! C’est recréer les conditions neuropsychologiques du désir et de l’attachement sécurisé. Nuance.

4.5 Créer un cadre relationnel stable : le pilier anti-chaos pour le couple moderne
Les couples qui fonctionnent n’improvisent pas leur relation. Ils ont un cadre.
Un cadre n’est ni rigide ni autoritaire. C’est un système d’organisation du lien qui réduit l’incertitude, la charge mentale et les tensions.
Un bon cadre relationnel inclut :
✔ 1. Un temps hebdomadaire dédié au couple
20 minutes, calme, régulier, non conflictuel.
✔ 2. Un partage explicite et durable des responsabilités
Non négocié chaque semaine.
Non débattu à l’infini.
✔ 3. Un espace de parole coupé du quotidien
Un espace sans écran, sans enfants, sans logistique.
✔ 4. Un espace sécurisé pour la sexualité
Sans pression, sans attente, mais avec intention.
✔ 5. Une logique de coopération plutôt qu’une logique de négociation
Selon la systémique de Palo Alto :
➡️ on ne négocie plus des tentatives de solution inefficaces,
➡️ on ajuste la danse relationnelle globale.
Ce cadre restaure :
-
la sécurité,
-
la prévisibilité,
-
la détente,
-
le désir,
-
la lisibilité,
-
l’équilibre.
Quand ces cinq éléments sont en place (pour rappel, ces 5 éléments sont clarifier les rôles, rééquliibrer la charge mentale, restaurer l'initiative relationnelle, redonner de l'espace interne à la femme et créer un cadre relationnel stable), alors on constate les choses suivantes :
-
les hommes en transition sortent de la prudence excessive,
-
les femmes en surcharge respirent,
-
les couples (même queer) trouvent alors des modèles adaptés,
-
le système nerveux se régule,
-
l’attachement se stabilise,
-
l’espace psychique s’ouvre,
-
la sexualité se remet en mouvement,
-
la dynamique cesse d’être "subie",
-
le couple redevient lisible et désirant.
C’est la base minimale pour reconstruire un couple contemporain fonctionnel, sans revenir au patriarcat, sans renoncer au désir, sans se perdre dans la neutralisation.

FAQ - C’est quoi un homme déconstruit ? Comment se réinventer sans se perdre dans le couple ?
1. C’est quoi exactement un "homme déconstruit" ?
C’est un homme qui questionne les anciens modèles masculins (virilité dure, domination, absence d’émotion) et cherche une posture plus juste. Il se défait de scripts anciens sans encore savoir comment habiter les nouveaux.
C’est une transition, pas une identité.
2. Pourquoi parle-t-on surtout d’hommes urbains et diplômés dans ce phénomène ?
Parce que ce sont ceux exposés aux discours féministes, aux enjeux du consentement, à la charge mentale et aux normes égalitaires. La déconstruction concerne aussi d’autres milieux, mais de façon différente.
3. Pourquoi certains hommes "déconstruits" se sentent-ils perdus dans leur couple ?
Parce qu’ils savent ce qu’ils ne veulent plus être… mais ignorent encore comment être autrement.
Ils craignent d’être lourds, intrusifs ou "toxiques".
Résultat : une prudence excessive qui crée de la distance.
4. La déconstruction masculine peut-elle faire baisser le désir ?
Oui, si elle se transforme en neutralisation du désir. Ce n’est pas la déconstruction en soi qui engendre des conséquences délétères, mais le manque d’un nouveau modèle clair : désirant, respectueux et lisible.
5. Quels sont les signes qu’un homme est "trop déconstruit" ?
En clinique, je retrouve souvent :
-
une inhibition constante,
-
une absence d’initiative,
-
une peur d’être mal perçu,
-
une neutralité émotionnelle,
-
un retrait progressif,
-
une sexualité hésitante.
Ce n’est pas un manque d’amour : c’est un manque de repères.
6. La charge mentale féminine joue-t-elle vraiment sur la libido ?
Oui et massivement.
La charge mentale (organisation + anticipation + régulation émotionnelle) empêche la détente.
Un cerveau saturé ne peut ni désirer ni recevoir.
7. Comment savoir si ma charge mentale impacte mon désir ?
Les signes fréquents :
-
fatigue émotionnelle,
-
irritabilité,
-
absence de disponibilité,
-
sensation d’être "la mère du couple",
-
impression de porter tout le lien. Dans ces cas, la libido baisse mécaniquement.
8. Pourquoi les couples modernes se désorganisent-ils autant ?
Parce que les repères traditionnels s’effondrent sans qu’un modèle relationnel lisible ne les remplace.
Résultat :
-
rôles flous,
-
surcharge féminine,
-
prudence masculine,
-
désynchronisation affective.
9. Comment la théorie polyvagale explique-t-elle la baisse du désir ?
Sans sécurité relationnelle, le système nerveux passe en vigilance.
Le corps se protège au lieu de s’ouvrir.
Désir et vigilance ne coexistent jamais.
Le couple a besoin de co-régulation pour retrouver l’élan.

10. Quel est le lien entre homme déconstruit et troubles érectiles psychogènes ?
La prudence, la peur de mal faire, la pression intérieure et la honte bloquent le système érotique.
Le corps se retire avant même l’excitation.
C’est fréquent chez les hommes qui veulent "bien faire" mais se coupent de leur intensité.
11. Et dans les couples queer, est-ce pareil ?
Oui, même si les formes changent. Les questionnements suivants sont transversaux. :
-
répartition du care,
-
charge mentale,
-
initiative,
-
sécurité émotionnelle,
-
désir,
-
attachement
Les dynamiques sont circulaires, pas genrées.
12. Comment restaurer l’initiative sans devenir dominant ?
En travaillant :
-
l’intention claire,
-
la présence,
-
la consistance,
-
la régulation du stress,
-
une approche lente,
-
une initiative non performative.
Initier ≠ dominer.
Initier = orienter le lien.
13. Comment redonner de l’espace interne à la femme (ou à la polarité en surcharge) ?
En réduisant réellement la charge mentale :
-
anticipation partagée,
-
autonomie domestique,
-
participation au care émotionnel,
-
moins de micro-demandes,
-
partage stable des responsabilités.
Quand la surcharge baisse → le désir revient.
14. Est-ce que la pornographie joue un rôle dans la confusion masculine ?
Oui. Le porno diffuse :
-
des scripts irréalistes,
-
une performance anxiogène,
-
une sexualité non relationnelle.
Chez l’homme déconstruit, cela accentue la peur d’initier et fragilise l’érotisme réel.
15. Comment la thérapie de couple aide-t-elle à sortir de ce blocage ?
En remettant :
-
de la lisibilité,
-
un cadre,
-
de la sécurité,
-
du corps,
-
des repères,
-
une compréhension circulaire,
-
une régulation émotionnelle,
-
du mouvement.
On ne "répare" pas un couple. On restructure son système relationnel.
16. Quand faut-il consulter ?
Quand vous vivez :
-
une baisse persistante du désir,
-
une surcharge mentale,
-
un malaise masculin ("je ne sais plus comment me comporter, comment être un homme"),
-
une dynamique en boucle,
-
une perte d’intimité,
-
une communication qui se répète.
Consulter tôt change tout.
17. Pourquoi la co-thérapie homme/femme (2 thérapeutes en thérapie de couple) est-elle si efficace en thérapie de couple ?
Parce qu’elle offre :
-
un miroir pour chacun,
-
un repère masculin sécurisé,
-
un repère féminin stable,
-
une lecture systémique croisée,
-
une présence double,
-
une neutralité plus robuste,
-
un espace où les deux se sentent représentés.
18. Comment commencer ce travail ?
En séance individuelle, en thérapie de couple ou en sexothérapie, je vous accompagne à :
-
clarifier vos rôles,
-
rééquilibrer la charge mentale,
-
restaurer l’initiative,
-
libérer la parole,
-
remettre du souffle dans la sexualité,
-
stabiliser le lien.
Les couples ne manquent pas d’amour : ils manquent d’un cadre qui les soutient.

Conclusion
La figure de l’"homme déconstruit" ne désigne ni un idéal moral, ni une rupture totale avec le passé. Elle décrit une réalité sociale située : celle d’hommes (surtout urbains et diplômés) pris entre la volonté de ne plus reproduire les anciens scripts masculins et l’absence de repères stables pour habiter une nouvelle posture. Cette transition rencontre aujourd’hui une charge mentale féminine documentée, massive, qui épuise, surcharge et réduit la disponibilité affective et sexuelle.
Ce croisement (prudence masculine d’un côté, saturation féminine de l’autre) crée une désynchronisation affective et sexuelle, qui n’est pas un échec conjugal mais le signe d’une désorganisation du système relationnel. Peu importe le genre ou la configuration du couple : hétéro, homo, queer, parental ou recomposé - les dynamiques restent circulaires, prévisibles et réparables lorsque l’on comprend comment elles s’articulent.
Ce que cette crise révèle de nos couples modernes
La situation actuelle ne s’explique ni par un problème d’individus ni par un déficit d’amour. Elle révèle un déficit de structure, dans une société où les attentes relationnelles n’ont jamais été aussi élevées et où les repères hérités ne suffisent plus.
Les couples contemporains vivent une triple pression :
-
psychologique (attachement, sécurité, régulation émotionnelle),
-
systémique (répartition des rôles, charge mentale, organisation du quotidien),
-
sexuelle (désir, initiative, pornographie, performances, troubles érectiles psychogènes).
La théorie polyvagale montre que, sans sécurité, le système nerveux se met en vigilance et coupe le désir.
La psychologie sociale démontre que les rôles flous génèrent du stress et des tentatives de solution inefficaces.
La systémie rappelle que chaque mouvement d’un partenaire influence le système entier.
La clinique montre que l’espace interne saturé de la personne en surcharge (le plus souvent la femme) réduit sa disponibilité.
Le problème n’est donc pas la déconstruction masculine en soi : le problème est l’absence d’un modèle relationnel alternatif, stable, lisible et incarnable.
Pour le dire autrement : une société qui transforme ses modèles amoureux doit nécessairement traverser cette crise structurelle. Le rôle de la thérapie est de permettre aux couples de ne pas s’y perdre.
La clé : accompagner la reconstruction, créer un cadre, redonner souffle et désir
Réinventer le couple moderne implique un accompagnement qui intègre toutes ces approches disciplinaires (la psychologie sociale, la clinique, la sexothérapie, la polyvagale, la systémie, le transgénérationnel, etc.). C’est un travail de précision essentiel : clarifier les rôles, redistribuer la charge mentale, restaurer l’initiative relationnelle, créer un cadre stable, réguler les systèmes nerveux, transformer les récits internes et rouvrir l’espace du désir.
Mon rôle, en séance individuelle, en thérapie de couple ou en sexothérapie, est justement d’offrir ce cadre : structurant, ajusté, incarné, profond. Et dès septembre 2026, les couples pourront également être accompagnés en co-thérapie avec Alexis Valentin et moi-même, pour une approche croisée homme/femme qui soutient encore mieux les dynamiques conjugales.
➡️ Les couples ne manquent pas d’amour.
➡️ Ils manquent de repères, de sécurité, de lisibilité et d’un cadre qui soutient leur évolution.
L’amour et le couple ne sont pas des projets personnels. Ce sont des chemins d’éveil.
Et lorsqu’ils sont accompagnés avec rigueur, profondeur et clarté, ils cessent d’être épuisants pour devenir, enfin, des espaces de transformation, de vérité, de souffle et de désir.
Si ce que vous vivez résonne (baisse du désir, surcharge mentale, malaise masculin, perte de repères, conflits récurrents ou impression de "ne plus se trouver" dans le couple) sachez que cela ne signifie pas que votre relation est vouée à s’éteindre. Cela signifie que votre lien arrive à un passage.
Je vous accompagne dans ces passages, en séance individuelle, en thérapie de couple ou en sexothérapie, en présentiel à Pessac ou en visio. https://www.neosoi.fr/
Nous travaillons ensemble à restaurer la clarté, l’équilibre, la sécurité, et à faire renaître un désir qui s’ancre dans le réel et pas dans les anciens modèles ni dans la performance.
Et à partir de 2026, vous pourrez également être accompagnés en co-thérapie avec Alexis Valentin et moi-même, pour une approche homme/femme qui permet d’avancer de façon encore plus juste et plus profondément dans la thérapie de couple.
➡️ L’amour et le couple sont des chemins d’éveil. Si vous sentez qu’il est temps de remettre du souffle, de la vérité et du mouvement dans votre lien, je vous accueille pour ouvrir ce travail ensemble.

Bibliographie
Ainsworth, Mary D. S. (1991). Attachement mère-enfant. Presses Universitaires de France.
Audibert, Catherine. (2018). Les blessures d’attachement. Payot.
Ayouaz, Djamila & Molinier, Pascale. (2005). « Le travail du care et l’invisibilité du féminin ». Cahiers du Genre, n°39.
Bacqué, Marie-Frédérique. (2015). Souffrances psychiques et société. Odile Jacob.
Bergeault, Margot. (2021). « Charge mentale et inégalités domestiques. » Revue Française de Sociologie, Cairn.
Bly, Robert. (1990). L’homme sauvage et l’enfant. Éditions de l’Homme.
Bogeat, Anne-Lise. (2018). « Attachement et traumatismes précoces en thérapie de couple. » Cairn.
Bowlby, John. (1984). Attachement et perte. Volume 1 : L’attachement. PUF.
Brenot, Philippe. (2017). Les hommes, le sexe et l’amour. Les Arènes.
Burgess-Proctor, Amanda. (2006). « Intersections de genre, race et pouvoir. » Feminist Criminology.
Castelain-Meunier, Christine. (2002). Les hommes aujourd’hui : virilité, égalité, identité. Payot.
Chollet, Mona. (2018). Sorcières : la puissance invaincue des femmes. Zones.
Chollet, Mona. (2021). Réinventer l’amour. La Découverte.
Cyrulnik, Boris. (2012). Autobiographie d’un épouvantail. Odile Jacob.
Cyrulnik, Boris. (2019). Le murmure des fantômes. Odile Jacob.
Chapitres sur la charge mentale (Monique Haicault, 1984). Sociologie du Travail.
Crépault, Claude. (2015). « Attachement et sexualité : interactions et enjeux. » Université Laval.
Daminger, Allison. (2019). « The Cognitive Dimension of Household Labor. » American Sociological Review.
Delphy, Christine. (1998). L’Ennemi principal. Syllepse.
Estés, Clarissa Pinkola. (1996). Femmes qui courent avec les loups. Grasset.
Epston, David & White, Michael. (1990). Narrative Means to Therapeutic Ends. Norton.
Eva Illouz. (2012). Pourquoi l’amour fait mal. Seuil.
Eva Illouz. (2006). Les sentiments du capitalisme. Seuil.
Gabor Maté, G. (2019). Quand le corps dit non. Payot.
Gabor Maté, G. (2023). Le mythe du normal. Éditions Quanto.
Giddens, Anthony. (1992). La transformation de l’intimité. Seuil.
Guédeney, Nicole. (2007). L’attachement : approche clinique. Masson.
Haicault, Monique. (1984). « La gestion ordinaire de la vie à deux. » Sociologie du Travail.
Hanot, Nathalie. (2020). Les blessures d’attachement : les comprendre et les dépasser. Mardaga.
Héril, Alain. (2019). Les hommes et l’amour. Payot.
Hochschild, Arlie. (1983). The Managed Heart (concept du travail émotionnel). University of California Press.
Illouz, Eva. (2007). Pourquoi l’amour fait mal. Seuil.
Klein, Marty. (2016). Sexual Intelligence. Tantor.
Le Camus, Jean. (2000). Parlons de l’attachement. Érès.
LeVine, K. (2021). « Masculinités contemporaines et anxiété de performance. » Cairn.info, Sociologie.
Lise Bourbeau. (1997). Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même. Éditions E.T.C.
Lopès, Patrice. (2015). Sexualités et couples. Masson.
Maltz, Wendy. (2012). The Sexual Healing Journey. Harper.
Merton, Robert K. (1996). Social Theory and Social Structure. Free Press. (normes sociales)
Mimoun, Sylvain. (2010). Le couple et le sexe. Albin Michel.
Molinier, Pascale. (2013). Le travail du care. La Dispute.
Monnin Gallay, Nathalie. (2018). Au cœur du désir féminin. Favre.
Nagoski, Emily. (2015). Come as You Are. Simon & Schuster.
Perel, Esther. (2015). Mating in Captivity. Harper.
Persiaux, Gwenaëlle. (2021). Guérir des blessures d’attachement. Solar.
Porges, Stephen. (2017). La théorie polyvagale. De Boeck.
Poudat, François-Xavier. (2019). « Sexualité et vulnérabilités conjugales. » Cairn.
Repond Monnier, Anne-Sylvie. (2020). Sexualité et trauma. Éditions Médecine & Hygiène.
Salomon, Paule. (1992). La femme solaire. Robert Laffont.
Stanislav Grof. (2009). Psychologie transpersonnelle. Éditions du Rocher.
http://https://shs.cairn.info/revue-mouvements-2004-1-page-11?lang=fr
https://shs.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2016-4-page-67?lang=fr
https://shs.cairn.info/revue-nouvelle-revue-de-psychosociologie-2014-1-page-83?lang=fr
https://shs.cairn.info/revue-actes-de-la-recherche-en-sciences-sociales-2016-5?lang=fr
https://shs.cairn.info/revue-sciences-sociales-et-sport-2021-1?lang=fr

NeoSoi - Dr Céline BERCION - psychologue sociale et systémique, psychothérapie, thérapie de couple et sexothérapie - Bordeaux et visio
36 Avenue Roger Cohé
33600
Pessac
Inscrivez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités

